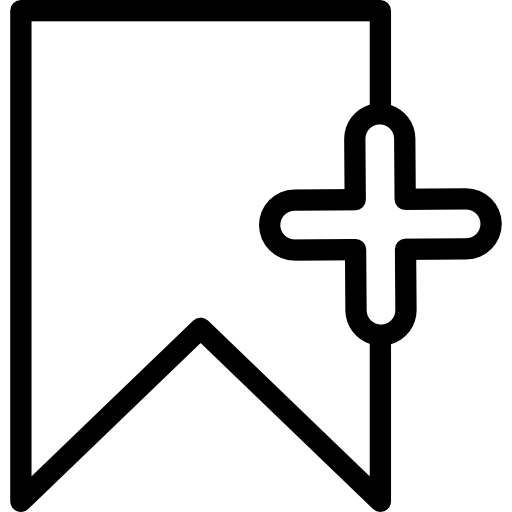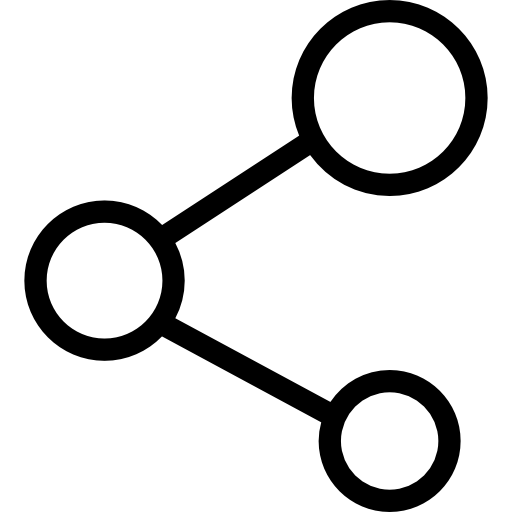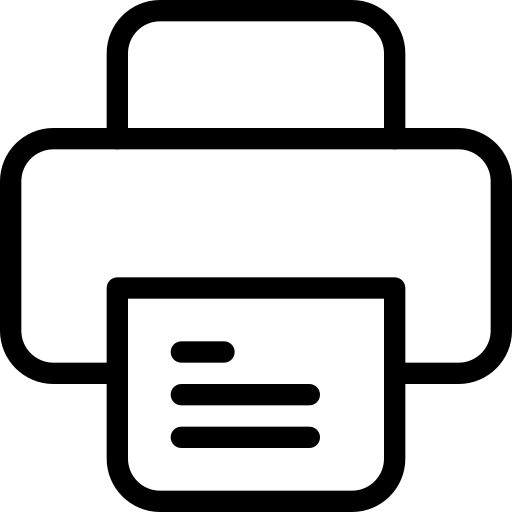Un manager peut-il être quelqu’un de bien ?
Publié le mercredi 8 juillet 2020 .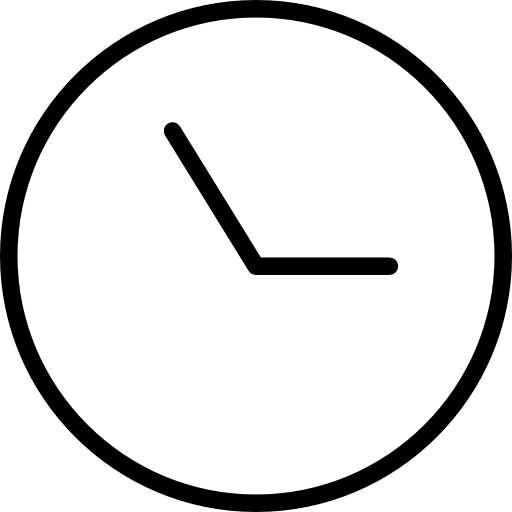 4 min. 08
4 min. 08
Imaginez un lieu où chacun pourrait se livrer à ses plus bas instincts et s’en donner à cœur joie. Un lieu où le mal pourrait être valorisé, où il serait tout simplement bien vu. Ce monde c’est celui que décrit la série télévisée Westworld : un parc dont le thème est de délester ses adeptes de toute obligation morale, de toute responsabilité. Un divertissement total, intégral, dans lequel ceux qui paient leur droit d’accès peuvent se permettre de faire tout et surtout n’importe quoi. Un monde sans punition, sans pénitence et sans peur.
Cette fiction donne à Laurence Devillairs, doyenne de la faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Paris, l’occasion de dénoncer une double hallucination : tout d’abord les adeptes de ce parc à thème ne sont pas libres, contrairement à ce qu’ils croient eux-mêmes en y participant, ils sont en quelque sorte tributaire du mal qu’il se plaisent à infliger.
Ensuite, cette fiction montre que faire le mal pour le mal n’est pas aussi plaisant que cela en à l’air de prime abord : ceux qui souffrent de cette méchanceté se rebiffent, et alors le divertissement par la haine montre ses limites. Vient le moment où le méchant doit nécessairement se regarder dans la glace, à la manière de Montaigne, « sans fausse honte, mais sans indulgence non plus » (p. 77).
Or c’est précisément là, selon l’auteur, que pour le méchant ordinaire les difficultés commencent. Car ce qui aurait dû avoir lieu, l’accomplissement du bien, ne s’est pas produit. Autrui nous appelle en effet à une distinction entre le bien et le mal : cet autrui qui n’est pas le « représentant d’un groupe » (p. 53) mais l’irremplaçable, l’unique, qui oblige en quelque sorte cet autre individu-singulier qui se regarde dans la glace de s’interroger aussi sur sa propre hypocrisie, et sur ce qui a été détruit. C’est le cynique, par exemple dans une entreprise, qui porte un regard soudain critique sur ses agissements. Le cynique c’est-à-dire celui qui fait dire à ceux qui ont subit ses affres qu’il, ou elle, n’est justement pas « quelqu’un de bien ».
Or cette expression que tout le monde connaît, qui sert à dire si quelqu’un est digne de confiance ou d’amitié, ou non, donne précisément son titre au livre. Quelqu’un de bien, ce serait celui qui se regarde dans la glace de sorte à être capable de se défaire de ses déterminismes, sociaux, économiques ou religieux afin de donner une chance, explique l’auteur, « à un autre type de causalité » (p. 81). Une telle personne hésiterait donc deux fois : en agissant bien ou mal d’abord, et en se demandant si elle a bien, ou mal, agit, ensuite. Et l’auteur de nous dire que la réponse n’est jamais automatique, qu’elle est volontaire, qu’elle nécessite le courage de se dire que commettre une faute n’est jamais le fruit du hasard ou de la malchance.
Sans le reconnaître explicitement, Laurence Devillairs trace en fait le portrait ici du collaborateur parfait. Quelle entreprise a jamais voulu faire autre chose qu’embaucher des « gens bien » ? Avoir des employés « à qui l’on tient » comme dit la chanson ? Et puis quoi de plus gratifiant pour quelqu’un de s’entendre dire qu’il est quelqu’un de bien ? C’est-à-dire, dans l’acception générale du terme, quelqu’un qui se conforme strictement à la morale du groupe, qui ne fera pas de vague, qui jamais n’osera remettre en cause la loi du plus fort ou du dernier qui a parlé.
Or le postulat de ce livre est que cette personne qui se regarde dans la glace, manageur ou managé, n’est justement pas ce collaborateur discipliné toujours prêt à obéir aux ordres, ce quelqu’un sans grand destin, mais un « héros du bien » qui « marche à contre courant » (p. 206-207). Pour être ce « brave », ce n’est pas du minimum qu’il faut se contenter, en étant ainsi le bon gars pour employer une expression courante et méprisante, mais faire le maximum, et renouer avec le caractère sublime, pour utiliser un terme kantien, de l’action morale.
Or le livre, et c’est là sa limite, semble toujours hésiter entre ces deux modèles. « D’une certaine façon, le héros n’a rien d’héroïque » (p. 197) en conclut l’auteur. Alors que tout le raisonnement, et c’est ce qui en fait la valeur, dit à peu près l’inverse. L’éthique n’est jamais une évidence. Car l’acte éthique est toujours une victoire. Et pour toute grande victoire, il faut un grand combat.
D'APRÈS LE LIVRE :

|
Être quelqu’un de bien
|
Les dernières vidéos
Management et RH

Les dernières vidéos
de Ghislain Deslandes

LES + RÉCENTES




LES INCONTOURNABLES