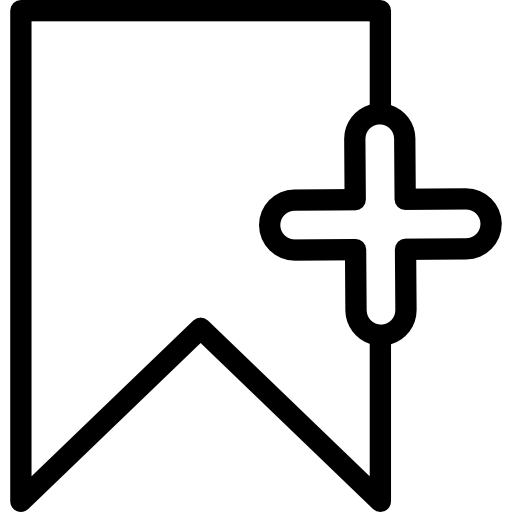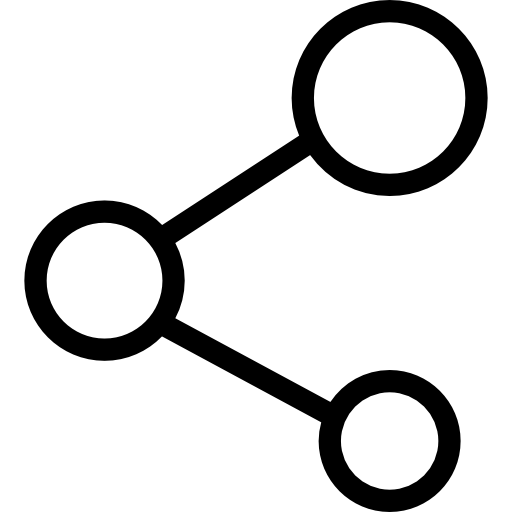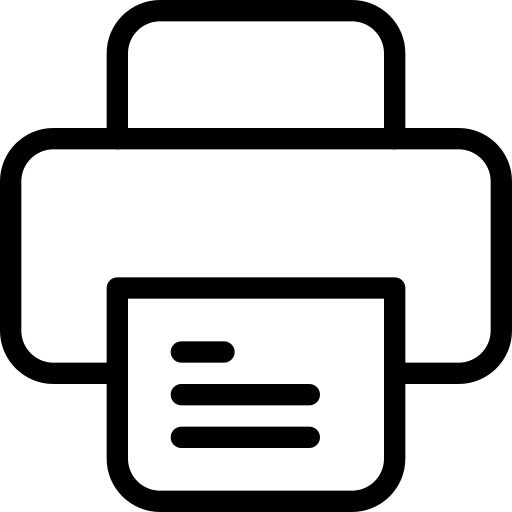On se sent à la fois plus cultivé et plus dubitatif en refermant le livre « Inégalité » de l’économiste américain James K. Galbraith. Cette version française de l’ouvrage initialement paru aux Presses d’Oxford dans la collection « Ce que chacun doit savoir » remplit ainsi sa mission : faire le point à 360 degrés sur ce thème brûlant tout en aiguisant le sens critique du lecteur.
La hausse des inégalités est une des caractéristiques de notre époque, dans de nombreux pays. Mais sa mesure comme son analyse posent de nombreuses questions …et parfois davantage qu’elles n’apportent de réponses. Qu’elles soient simplement de salaires ou de revenus, il y a inégalités et inégalités : plus on rentre dans le détail plus on s’y perd. James Galbraith explicite clairement les outils qui permettent de les mesurer ….mais aussi leurs limites. Même avec un appareil statistique perfectionné et en menant une étude sophistiquée, leurs mesures ne prendront pas en compte, par exemple, l’impact sur les revenus des ménages des coûts de l’éducation ou de la santé -selon qu’ils sont gratuits ou payants. …pas plus que le poids des taxes indirectes, qui pénalisent proportionnellement plus le budget des ménages les plus modestes.
Ces limites ne sont pas une raison pour ignorer le sujet même si, comme le note James Galbraith, les économistes l’avaient fait au moment où elles se réduisaient fortement, c’est-à-dire dans les décennies d’après-guerre, avant de s’y intéresser de nouveau plus récemment. Un symptôme de leur résurgence.
Après avoir évoqué les théories des grands auteurs, tels Karl Marx, Thorstein Veblen ou Simon Kuznets mais aussi Keynes, Schumpeter ou Adam Smith, l’auteur détaille également les travaux plus récents sur les inégalités : ceux de Thomas Piketty ou de Branko Milanovic, qui ont apporté de nouveaux éclairages, et bénéficié de plus grandes bases de données et d’une plus grande puissance de calcul que leurs prédécesseurs. Dans le cas de Thomas Piketty, James Galbraith formule plusieurs critiques ….où pointe peut-être une forme de rivalité entre économistes traitant de ces questions. Il critique notamment l’hypothèse, vérifiée au cours des dernières décennies, que le rendement du capital s’accroît davantage que celui du travail. Effectivement, un krach boursier ou immobilier peut changer la donne, de même qu’un retour de l’inflation pourrait rogner les patrimoines financiers. Tout en gardant en tête ces observations, elles n’infirment cependant pas les constats de Thomas Piketty.
Mais le livre ne s’arrête pas à ces querelles, et fournit un panorama complet des différents facteurs à l’origine de la croissance ou de la décroissance des inégalités ainsi que les impacts possibles des inégalités sur la bonne marche de l’économie, mais aussi de la démocratie, la concentration de richesses étant aussi une concentration du pouvoir. Il témoigne aussi du regard d’un économiste keynésien américain : il souligne notamment que les inégalités entre les nations européennes restent bien plus élevées que celles entre les cinquante Etats des Etats-Unis.
C’est cependant la digression finale de James Galbraith qui offre la plus grande touche d’originalité à son ouvrage : selon ses recherches menées dans le cadre de l’University of Texas inequality Project, l’égalité économique favorise la victoire militaire : dans l’Histoire, les guerres ont le plus souvent été gagnées par les Etats les plus égalitaires contre leurs adversaires moins égalitaires. Et cette affirmation est encore plus vraie, analyse l’économiste, lorsque l’Etat le plus égalitaire est une démocratie. On le voit : de nombreux champs de bataille s’ouvrent encore à la recherche sur les inégalités.
Publié le vendredi 7 juin 2019 . 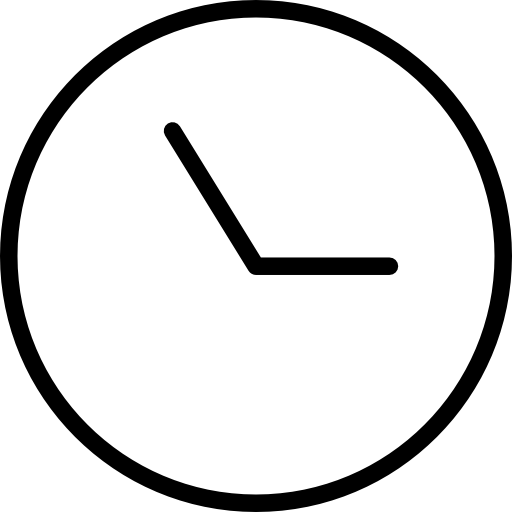 3 min. 47
3 min. 47
D'APRÈS LE LIVRE :
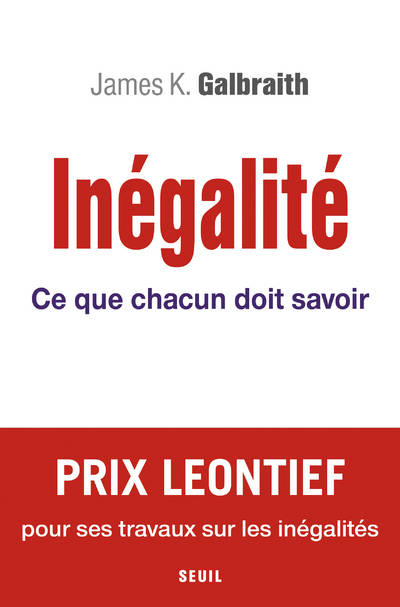
|
Inégalité - Ce que chacun doit savoir
|
Les dernières vidéos
Idées, débats


Les dernières vidéos
d'Adrien de Tricornot


LES + RÉCENTES
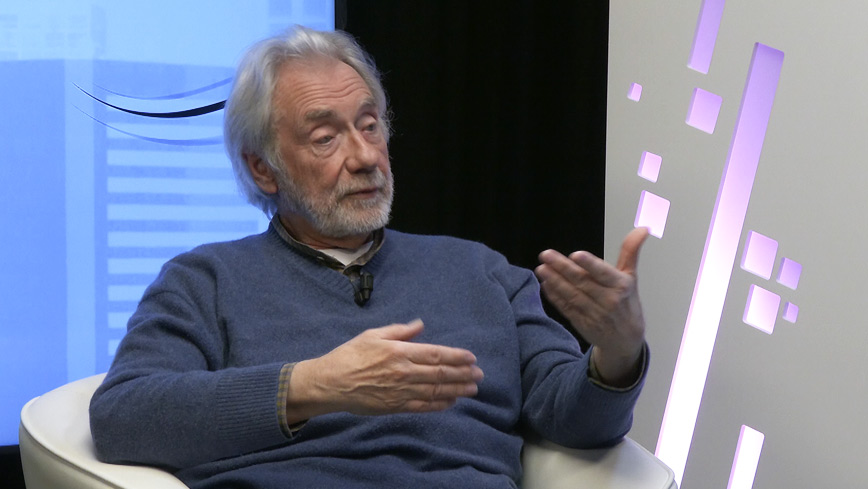
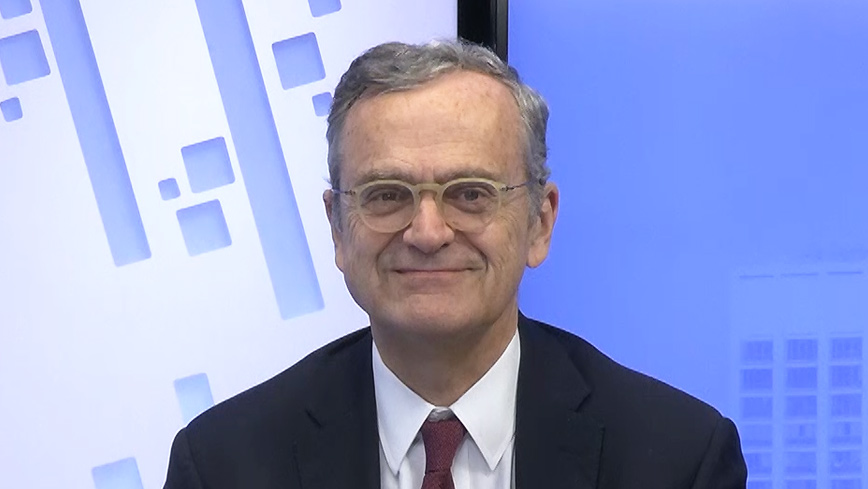


LES INCONTOURNABLES