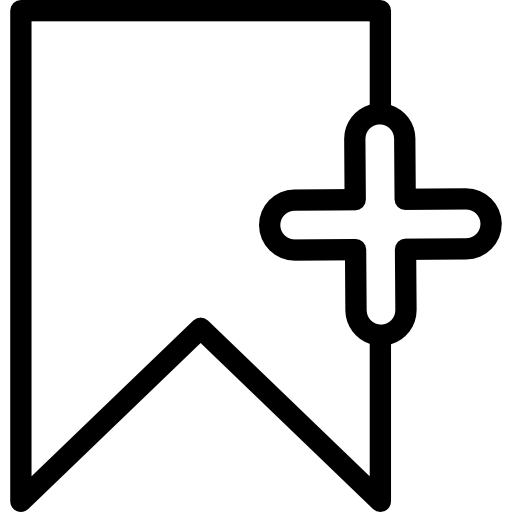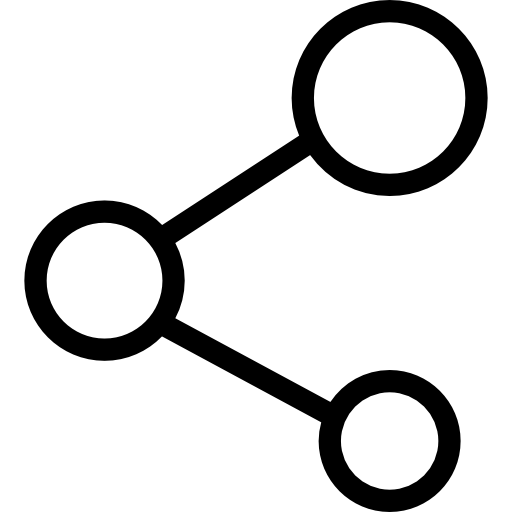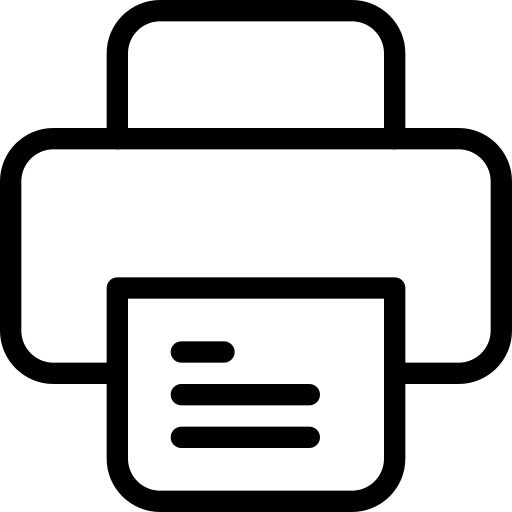Dans son livre intitulé "L'archipel français", le sondeur Jérôme Fourquet décrit, nombreuses statistiques à l'appui, le processus de dislocation progressive de la société française en une multitude de communautés qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Lors de sa parution, c'est surtout l'importance du repli ethnoreligieux (bien réel) qui a attiré l'attention des médias. Or, un autre tendance, certes moins visible, est également à l'œuvre dans cette archipel-isation : il s'agit de la sécession des élites, qui s'est accélérée depuis une trentaine d'années.
Si bien qu'aujourd'hui, "les membres de les membres de la classe supérieure se sont progressivement coupé du reste de la population et se sont ménagers un entre-soi bien confortable pour eux", écrit l'auteur. Ce séparatisme se caractérise davantage par un recul de la mixité sociale que par le développement des inégalités, qui, se sont d'ailleurs moins creusées en France que dans les autres pays, notamment après la crise 2008.
Les trois dimensions de ce séparatisme sont d'ordre géographique, culturel, et idéologique.
Géographique d'abord, avec une densité de cadres et professions intellectuelles dans les grandes métropoles françaises qui n'a eu de cesse de se renforcer. Ainsi, à Paris, les cadres représentaient seulement 24,7 % de la population active en 1982, contre 46,4 % en 2013. Dans des proportions moindres, on observe le même phénomène à Lyon, Toulouse, Strasbourg ou à Nantes
Culturel, ensuite, ce que l'auteur illustre en étudiant l'évolution la population fréquentant l'enseignement privé. Si ce dernier scolarise toujours environ 15% des élèves depuis 30 ans, sa composition a bien changé. En effet, la proportion des enfants issus de familles favorisées y sont désormais deux fois plus nombreux que dans le public : 36 % contre 19 %. C'était beaucoup moins marqué en 1984 avec 26 % contre 18 %.
La troisième dimension est d'ordre idéologique. Elle est sans doute étroitement liée aux deux autres, tant l'éloignement complique la compréhension des attentes des classes populaires par les élites. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP, a justement mesuré le décalage de perception et d'opinion entre les CSP+ et le reste de la population. Si 77 % des hauts revenus pensent que la transformation de la France en profondeur pour s'adapter à la mondialisation doit être la priorité politique, le reste de la population n'est que 56 % à le penser. A l'inverse, 44% du reste de la population souhaiterait accorder la priorité à la préservation de l'identité du pays face à la mondialisation, deux fois plus que chez les hauts revenus.
Alors comment en est-on arrivé là ? Pour l'auteur, et c'est assez frappant, l'un des "ressorts majeur de ce processus et à chercher dans la nouvelle stratification éducative de la société, engendrée par l'augmentation très significative de la proportion de diplômés du supérieur".
Pour Emmanuel Todd, citée par l'auteur, cette situation à abouti au fait que, "pour la première fois les éduqués supérieure peuvent vivre entre eux produire et consommer leur propre culture. Autrefois, écrivains et producteurs d'idéologies devaient s'adresser à la population dans son ensemble (...). L'émergence de millions de consommateurs culturels de niveau supérieur autorise un processus d'involution. Le monde dit supérieur peut se refermer sur lui-même, vivre en vase clos et peut développer, sans s'en rendre compte, une attitude de distance et de mépris vis-à-vis des masses du peuple, et du populisme qui né en réaction à ce mépris". Et constat souligne bien que cette sécession n'est entre autre qu'un cercle vicieux dont il sera très difficile de sortir.
Publié le vendredi 18 octobre 2019 . 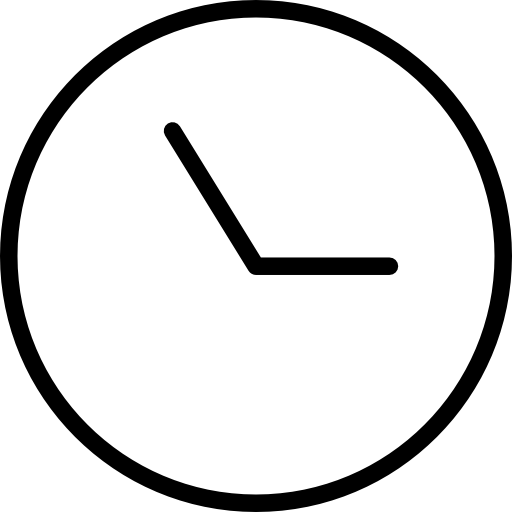 4 min. 18
4 min. 18
D'APRÈS LE LIVRE :
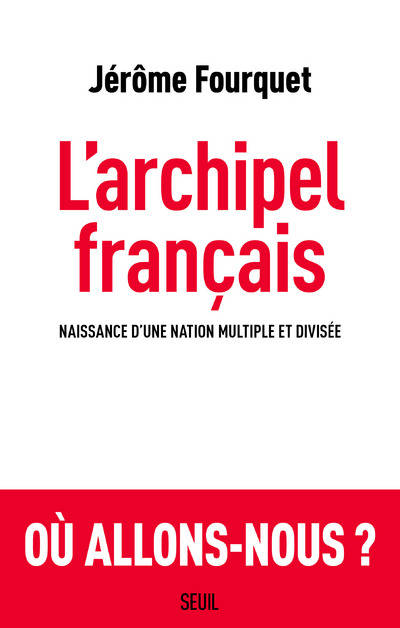
|
L'archipel français
|
Les dernières vidéos
Idées, débats


Les dernières vidéos
de Thibault Lieurade

LES + RÉCENTES
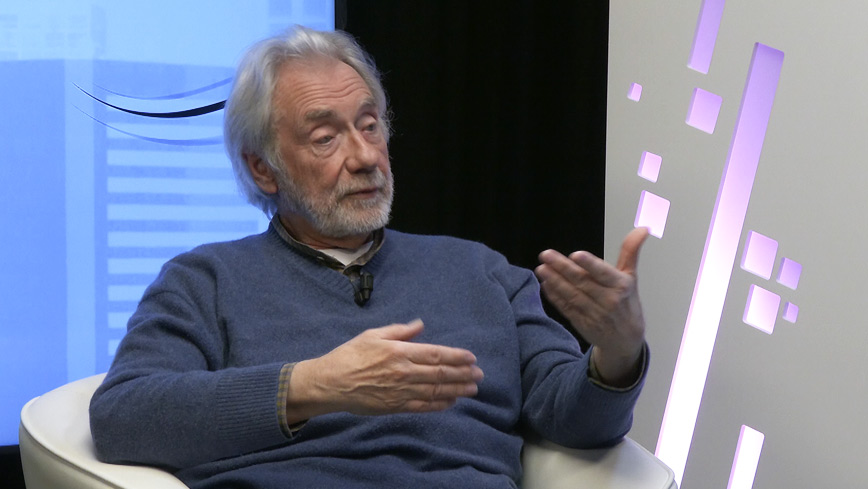
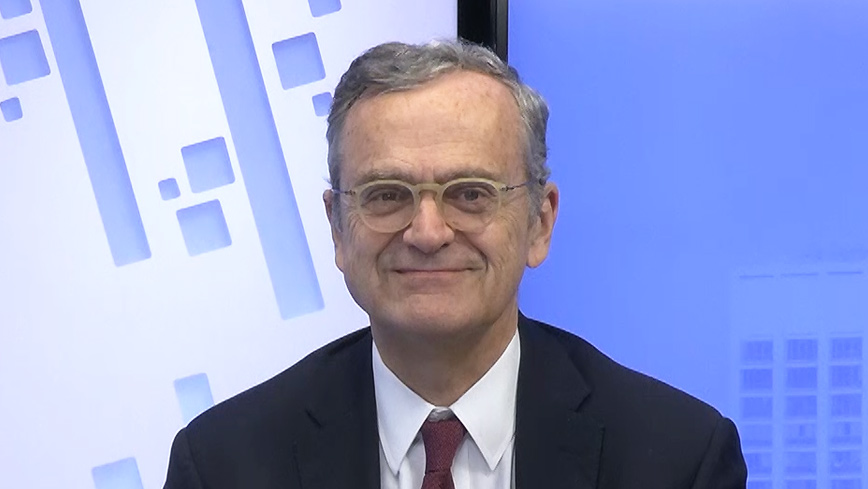


LES INCONTOURNABLES