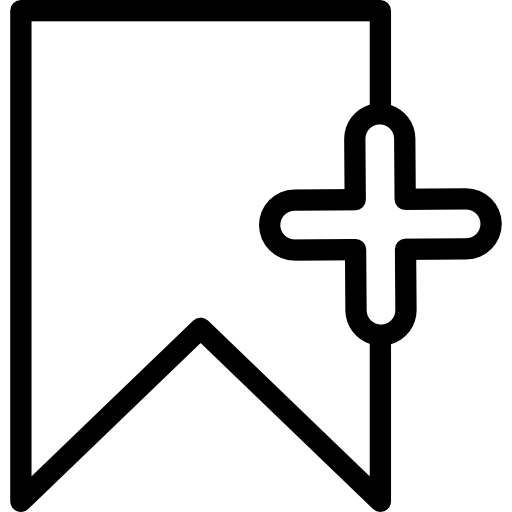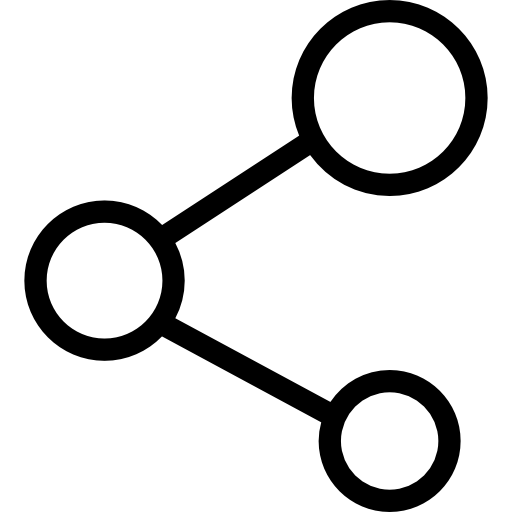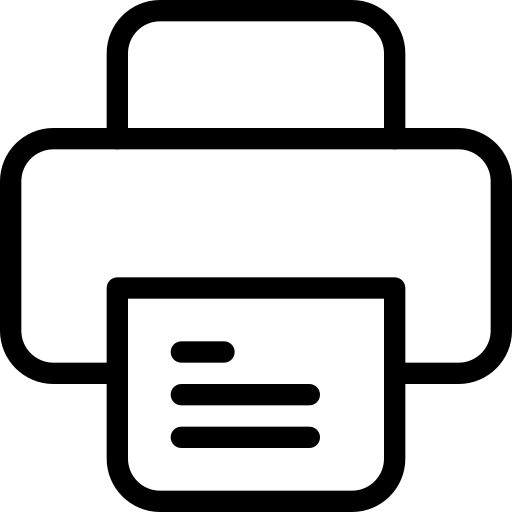« Vous devez être heureux d’être là. Vous servirez nos intérêts de court-terme. Votre job sera stressant et vous serez monitoré et surveillé constamment. Nous mesurerons vos performances grâce aux données. Vous pourriez être viré sans raison à tout moment. Nous n’avons pas de crèche mais nous avons une table de ping-pong, avec des bières et des sandwichs dans le frigo. » Bienvenue dans votre nouveau job.
Avec cette mise en bouche dès l’introduction de son dernier livre intitulé Rats de laboratoire (Lab Rats en anglais), le journaliste spécialisé en technologie Dan Lyons, nous livre en pâture les modes de management pourtant célébrés de l’Ouest des Etats-Unis. Notamment ceux des grandes entreprises du numérique, qu’il appelle les « ateliers de misère » de la Silicon Valley. Et le moins que l’on puisse dire est que le portrait qu’il en fait ne suscite guère l’admiration généralement entendue.
Pour cela, il oppose deux séries de faits :
-en premier lieu il évoque l’arrogance et les egos surdimensionnés des « héros » du numérique. Il dénonce le caractère contradictoire de certains discours comme ceux de ces deux entrepreneurs qui militent pour la démocratisation de la politique américaine mais qui s’agissant de leurs propres affaires créé différentes classes d’actions leur permettant de diriger leur empire comme des « dictateurs bienveillants » (p. 42). Il note aussi la terrible déclaration du chef des opérations techniques de Uber, six mois après le suicide d’un ingénieur, qui déclarait que travailler dans cette entreprise rappelle la formation des diamants, comprimés par la chaleur et la pression durant des milliers d’années, mais qui à l’issue du processus brillent comme personne. » (p. 116). Il invalide aussi la politique RH de Netflix qui proclame être « une équipe, pas une famille », et qui tend selon lui à ne tenir aucun compte des conséquences psychologiques pour celles et ceux qui doivent faire leurs bagages du jour au lendemain. En fait, comme le fait remarquer une étude réalisée par un psychologue de l’Université Catholique de Louvain citée par Lyons, l’insécurité de l’emploi tend à faire diminuer la créativité, baisser la productivité, et augmenter les possibilités de harcèlement sous toutes ses formes (cf. p. 118). Il disqualifie enfin les modes de management alternatif comme l’holacratie, qui ont fait leur apparition ces dernières années, « comme une dose de foutaise mixée au LSD et servie par Charles Manson » (p. 125).
-Face à tant et tant d’hubris et d’autocélébration de la part des entrepreneurs de la Silicon Valley, le journaliste note (p. 24) que selon l’institut Gallop seulement 13% des travailleurs se sentent activement « engagés » dans leur entreprise, ce qui est somme toute très peu. Il remarque également que beaucoup des grandes entreprises américaines issues du numérique ne sont pas particulièrement profitables ni bien gérées. Elles le sont souvent par des personnalités qui n’ont aucune science du comportement organisationnel mais qui connaissent seulement la manière de mettre leur société en bourse et de savoir partir en tirant les marrons du feu. Tesla, Spotify, Dropbox, Snap, Docusign, toutes des sociétés cotées, perdent de l’argent selon l’auteur, parfois en grande quantité, souvent depuis longtemps. Même chose avec Uber, Lyft, Airbnb, Slack, Pinterest ou WeWork, à la différence que ces dernières demeurent non-cotées.
Au final, cet essai tend à démontrer que ces gens de la Côte Ouest des Etats-Unis qui disent vouloir faire un monde meilleur en construisent un qui paraît parfois pire, en tout cas sur la question précise du bien-être de leurs propres salariés. Au fond il n’est même pas sûr que ces « entrepreneurs de pacotille », selon les termes de l’auteur, savent véritablement ce qu’ils font.
Et si parfois l’auteur se perd un peu, comme lorsqu’il reproche à Netflix d’être une équipe et non une famille, ce qui n’est peut-être après tout une mauvaise nouvelle pour personne, il est convaincant lorsqu’il montre qu’un autre capitalisme est possible en citant toute une série d’exemples, aussi bien dans l’industrie logicielle -la société Basecamp à Chicago- que dans la banque d’affaires -avec Kaport Capital basée à Oakland. En militant aussi pour une économie « durable », fondée, non sur des principes scientifiques pour résoudre des problèmes qui ne le sont pas, mais sur les valeurs de dignité et de respect à l’égard des parties prenantes.
Réf.
Lyons, D. (2019). Lab rats – why modern work makes people miserable. Atlantic books.
Publié le mardi 2 février 2021 . 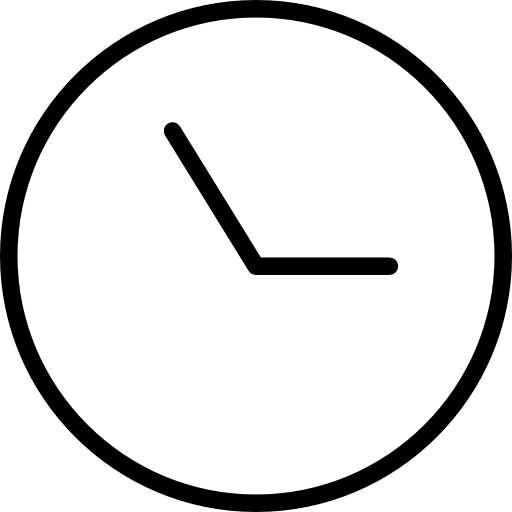 4 min. 10
4 min. 10
D'APRÈS LE LIVRE :
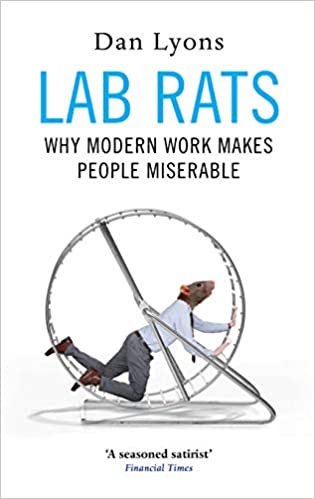
|
Lab rats – why modern work makes people miserable
|
Les dernières vidéos
Idées, débats


Les dernières vidéos
de Ghislain Deslandes

LES + RÉCENTES
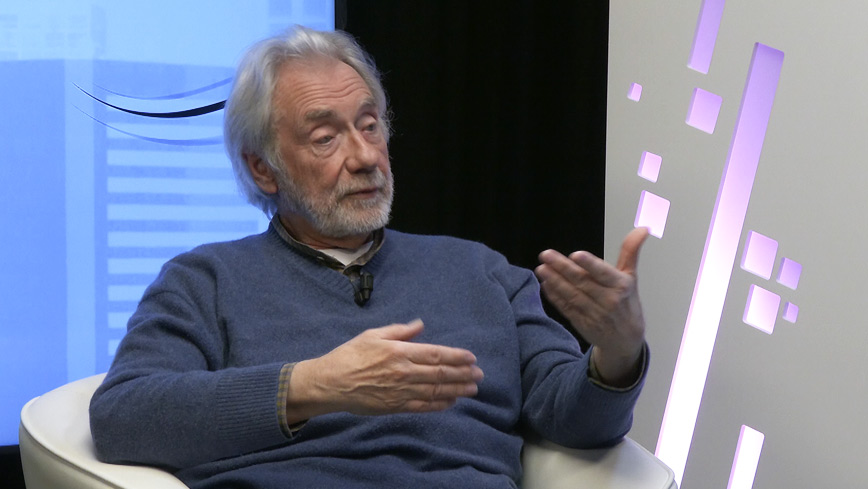
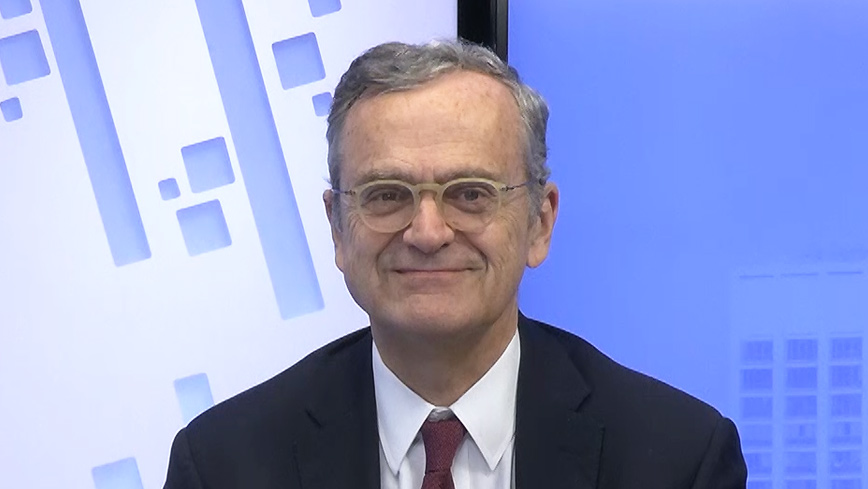


LES INCONTOURNABLES