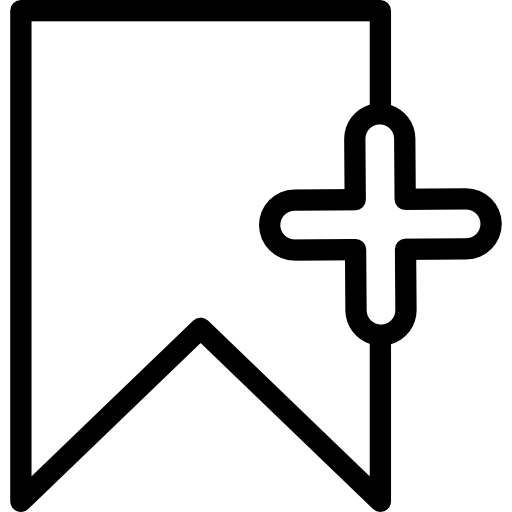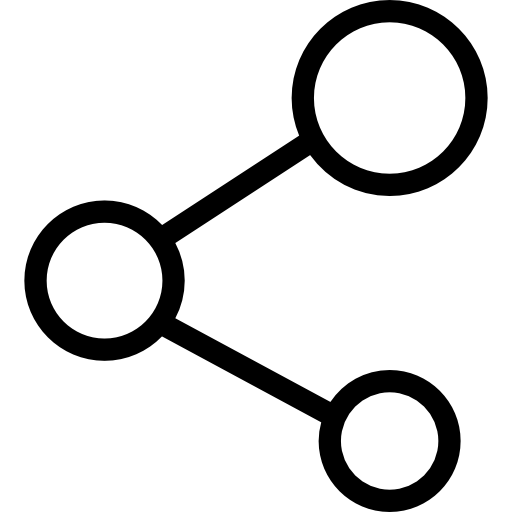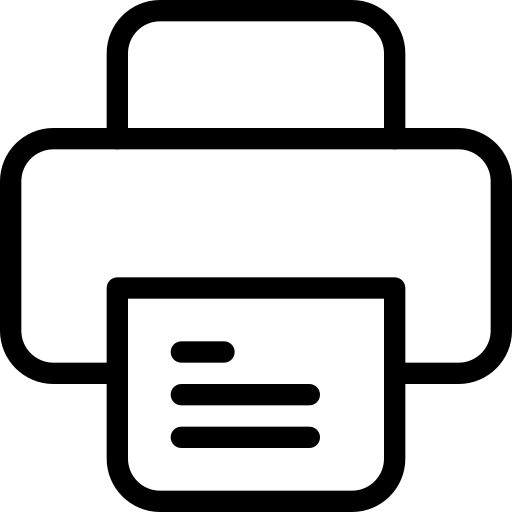La recherche en sciences de gestion ne cesse de mettre en avant une notion qui, en apparence, paraît facile à comprendre : celle de leadership authentique. Face à la crise de confiance dans les élites, la valeur d’authenticité serait de nature à rétablir crédit et autorité. Etre authentique pour un dirigeant ou une dirigeante cela signifie : respect de ses engagements, conscience morale attestée et désir de satisfaire les besoins du groupe avant les siens. Ce modèle semble avoir supplanté tous les autres, le leadership directif voire autoritaire, visionnaire ou transactionnel. Il suffirait donc d’être soi-même pour être soi-même un bon leader.
Or dans son essai le sociologue et essayiste Gilles Lipovetsky, dont le travail est bien connu des gestionnaires depuis la parution notamment de l’Empire de l’éphémère, s’interroge sur cette notion que beaucoup revendiquent et qui constitue selon lui un fait inédit dans les sociétés humaines, soucieuses auparavant de fonctionner sous le régime de « la scrupuleuse obéissance aux prescriptions collectives » (p. 29).
De sorte que l’authenticité se retrouve aujourd’hui dans les produits que nous achetons, dans les associations auxquelles nous adhérons, et dans les programmes politiques que nous soutenons. Et tout y passe : si Trump est élu malgré qu’il prononce « entre sept et seize fausses nouvelles par jour » (selon le Washington Post), c’est parce qu’il parle avec ses tripes, sans médiation. Si une épouse ou un mari se montrent infidèles ce serait pour « se sentir fidèle avec soi-même » écrit l’auteur (p. 97). Si de plus en plus de personne ont recours à la chirurgie esthétique, ce n’est pas pour se montrer en spectacle mais au contraire pour apparaître aux autres tels qu’ils se perçoivent eux-mêmes. Si l’artiste russe Piotr Pavlenski s’offre de montrer publiquement des photos privées de Benjamin Griveaux, ce serait prétend-t-il au nom d’un certain idéal d’authenticité. Enfin si les produits naturels ont plus de succès en tout, vêtement, laitages, vin bio ou destination touristique, c’est pour la seule et même raison qu’ils apparaissent plus authentiques, proches de nous, et sans mise en scène forcément mensongère. D’ailleurs la culture d’authenticité n’a eu de cesse ces dernières années de se répandre jusque dans les organisations, au travers de ce qu’il est convenu d’appeler le « développement personnel », supposé augmenter le niveau de confiance en soi des collaborateurs qui suivent ces programmes.
C’est dans ce cadre général que Gilles Lipovetsky propose toutefois trois analyses susceptibles d’éclairer notre jugement :
-premier point il note que la soif de vie authentique dans la vie économique est une revendication tout à fait nouvelle. Le consumérisme au XXème siècle s’étant en grande partie développé contre, justement, cet idéal de vie authentique. Il s’agissait alors de « sortir de soi » en profitant des avantages de la société matérialiste.
-second point il fait remarquer que ce goût soudain pour l’authenticité de l’existence s’est affirmé au moment même, je le cite, de « l’éclipse de son aura philosophique » (p. 11). Chez des philosophes aussi différents que René Girard, Jacques Derrida ou Jean Beaudrillard, l’authenticité y est dénoncée comme une imposture à l’égard de soi. Nous serions chacun d’entre nous les moins bien placés finalement pour savoir qui nous sommes.
-troisième point, l’auteur remarque (p. 18) que la « phase performantielle et utilitariste de l'authenticité a pris la relève de son moment éthico-idéaliste ». « Be yourself », cela signifierait donc moins ‘connexion avec son moi profond’ que simple expression de nos désirs les plus immédiats, et les plus conformistes.
Dès lors, il y a fort à parier que « les odes à l'authenticité ne sont pas à la hauteur des défis collectifs et planétaires de notre époque », ainsi que l’indique Lipovetsky (p. 415). C’est aussi vrai en matière de leadership, car dans ce domaine, comme l’ont mis en valeur les recherches de la Professeure Herminia Ibarra de la London Business School, l’action influe toujours sur qui nous sommes et ce que nous croyons savoir de nous-mêmes. Ce n’est pas l’étalage des états d’âmes qui fait le leader, mais sa plasticité consistant à intégrer les leçons du passé et du présent pour envisager les nouvelles conditions du devenir. Le « devenir » fut d’ailleurs une préoccupation majeure de deux philosophes cités dans le livre, d’abord Kierkegaard, hélas cité à contre-emploi, et son presque contemporain Nietzsche qui dans le paragraphe 40 de Par-delà le bien et le mal, écrivait à toutes fins utiles cette pensée qu’il appartient à chaque leader de méditer : « tout esprit profond a besoin d’un masque ».
Publié le lundi 21 février 2022 . 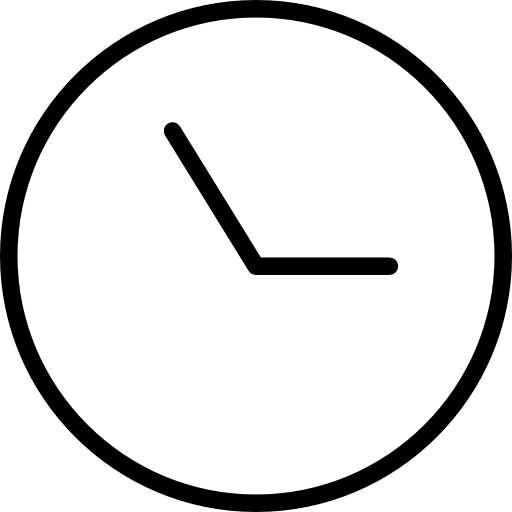 4 min. 11
4 min. 11
D'APRÈS LE LIVRE :
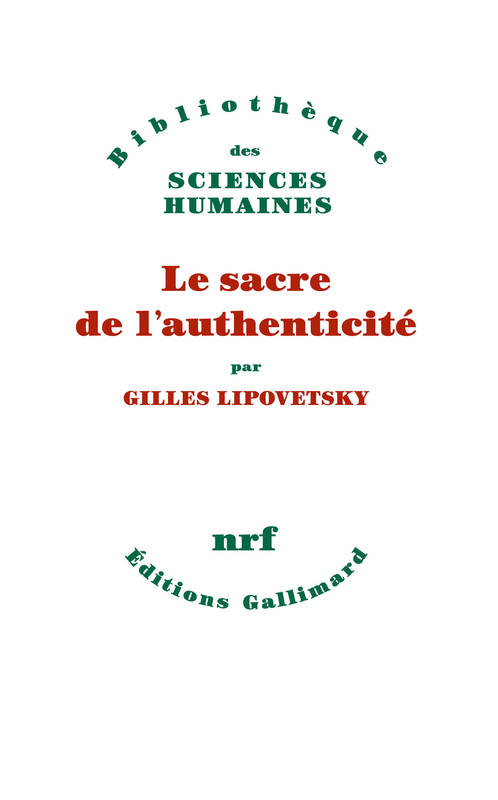
|
Le sacre de l'authenticité
|
Les dernières vidéos
Idées, débats


Les dernières vidéos
de Ghislain Deslandes

LES + RÉCENTES
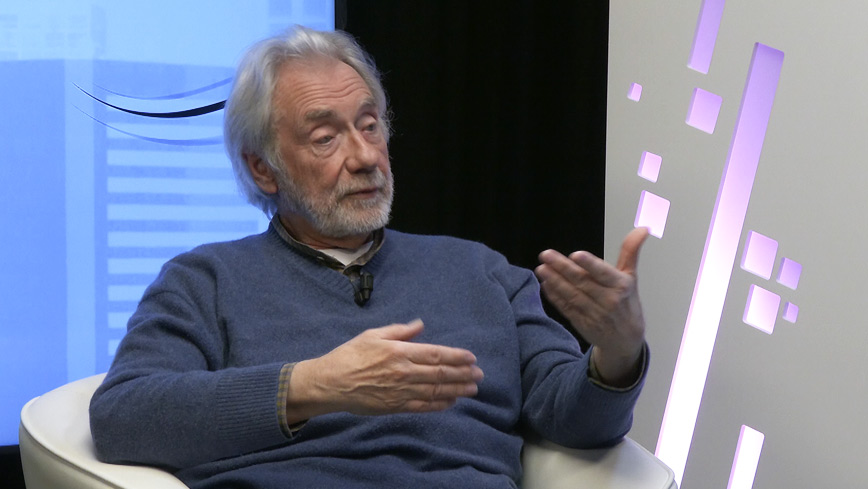
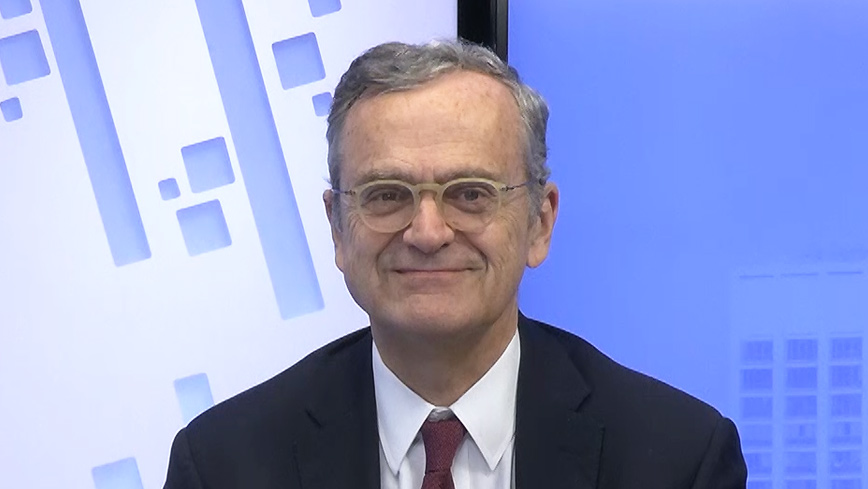


LES INCONTOURNABLES