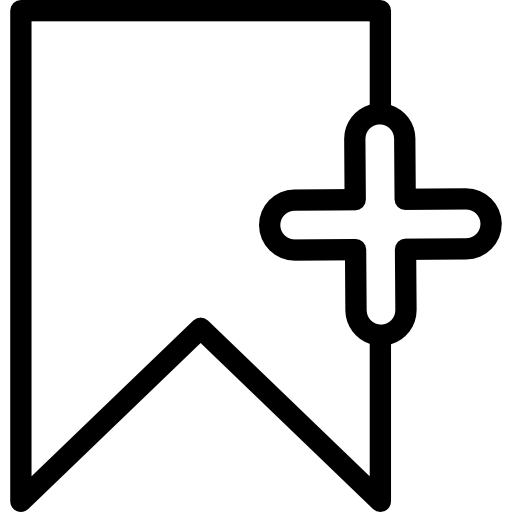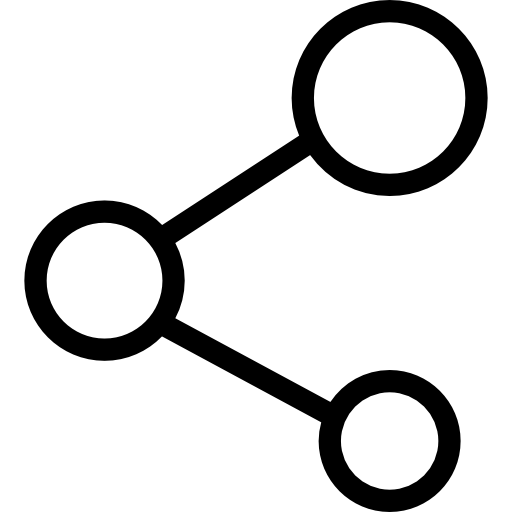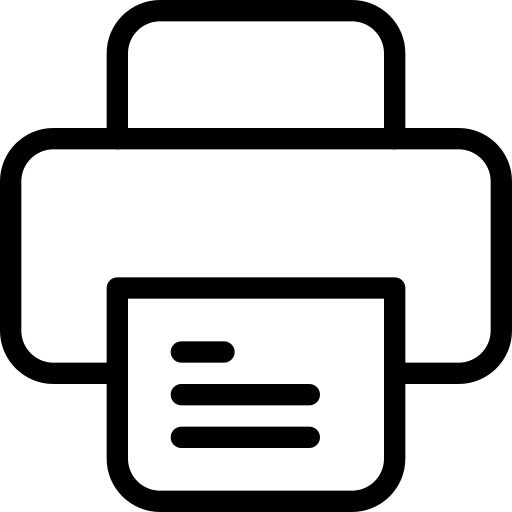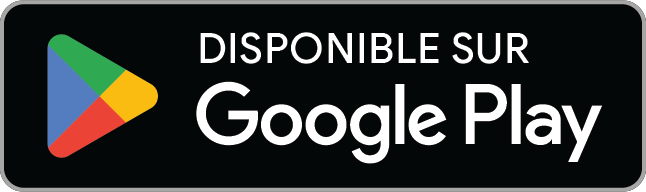Élection après élection, la liste des pays émergents dirigés par des populistes s’allonge. Il y a d’abord les historiques : le Venezuela de Chavez puis de Maduro ; la Turquie d’Erdogan depuis 2003. L’histoire s’accélère ensuite à partir de 2010. Viktor Orban prend la tête du gouvernement hongrois en mai de la même année, Narendra Modi devient premier ministre en Inde en mai 2013 et coup sur coup c’est l’arrivée au pouvoir d’Andrzej Duda en Pologne en 2015, Pologne qui avait déjà versé un première fois dans le populisme au milieu des années 2000 avec les frères Kaczynski, mais c’est aussi Rodrigo Duterte aux Philippines en 2016, suivi d’Andrej Babis en République tchèque en 2017 et plus récemment encore de Jair Bolsonaro au Brésil à l’automne 2018 et cette liste n’est pas exhaustive.
L’héritage de Lehman Brothers
Les racines de cette vague antisystème sont multiples, toutefois les ressorts qui l’alimentent restent en grande partie économique et social. Un premier indice, c’est le calendrier même du retournement en faveur des candidats populistes : sur les 8 pays passés en revue, une majorité bascule après 2008-2009, soit après la grande récession. Le populisme c’est donc en partie l’héritage de Lehman Brothers. Les résultats d’une étude du CEPR, un centre de recherche économique américain qui a analysé 800 élections de 1870 à 2014 dans 20 démocraties avancées, révèlent, qu’en moyenne, les votes en faveur des partis antisystèmes augmentent d’un tiers les années suivant les crises financières.
Or, la crise financière de 2008-2009 est la plus violente depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une crise à l’origine de la grande frustration d’une partie de la classe moyenne émergente. Face à l’accélération de l’histoire, elles avaient nourri beaucoup d’ambitions. Selon le FMI, le PIB en volume par habitant des pays émergents a bondi au rythme exceptionnel de 5% du début des années 2000 jusqu’en 2007 pour retomber à 3,5% de 2010 à 2017 avec d’énormes disparités géographiques.
Au Brésil, le PIB par habitant recule de façon quasi-continue depuis 2014. En clair, une partie des Brésiliens s’est appauvrie ces dernières années dans l’un des pays les plus inégalitaires au monde où 10% des plus gros revenus trustent 56% du revenu national.
Inégalités et corruption
Si la chute de la croissance et celle des revenus qui l’accompagne reste une exception, la tendance est bien au ralentissement général avec, en plus, un point commun à tous, la montée des inégalités : la part de revenu national allant aux 10% des plus gros revenus est passée de 26 à 28% en République tchèque, de 34 à 39% en Pologne, de 41 à 56% en Inde, laissant ainsi sur le côté un nombre croissant de personnes dont le mécontentement est à la hauteur des espérances passées et qui voient s’enrichir une élite hors sol.
Avec en sus des problèmes de corruption qu’il est possible d’objectiver. L’ONG anticorruption Transparency International établit un classement sur 176 pays portant sur la perception de la corruption sur une échelle de 1 à 100 (du plus vertueux au plus corrompu). L’Allemagne et la France pris comme étalons occupent respectivement la 12ème et 23ème places avec des notes de 81 et de 70. Les pays de l’Est récemment passés aux mains de partis antisystème se situent un cran en dessous voir à un niveau assez bas comme la Hongrie en 66ème position. Mais c’est en Inde et encore plus au Brésil (96ème position) et aux Philippines (111ème) que la corruption est la plus élevée hissant ces pays parmi les plus corrompus de la planète.
Revenus en fort ralentissement, voire en recul, montée des inégalités et perte de crédibilité des élites, c’est le cocktail gagnant du populisme. Et à des degrés divers, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les pays émergents comme dans les pays avancés.
Publié le jeudi 8 novembre 2018 . 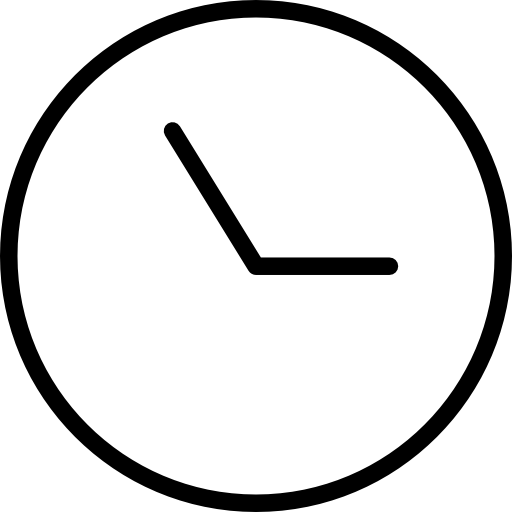 4 min. 02
4 min. 02
Les dernières vidéos
Économie mondiale


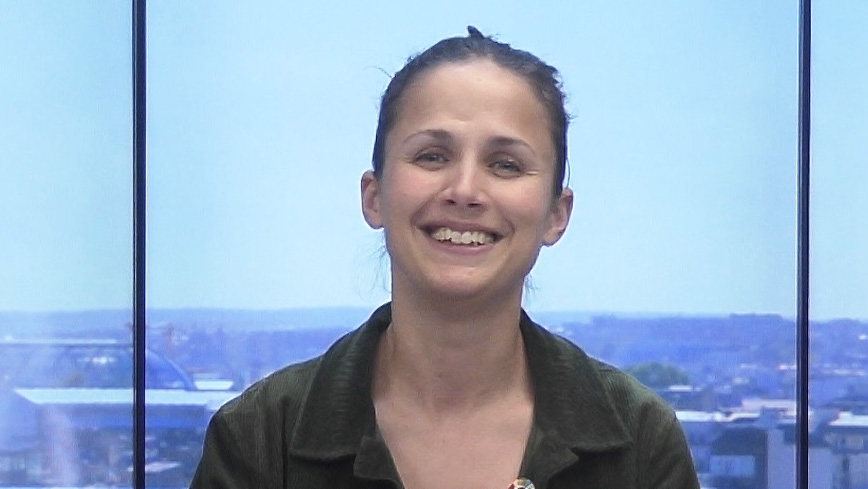

Les dernières vidéos
d'Alexandre Mirlicourtois



LES + RÉCENTES
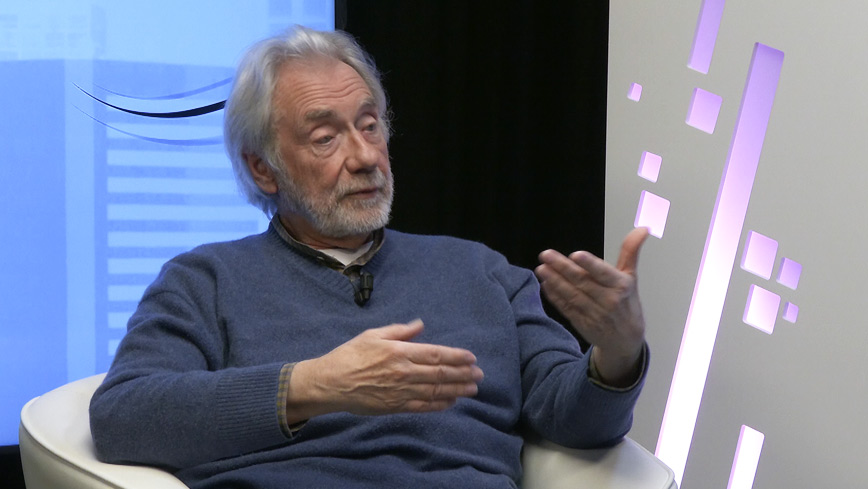
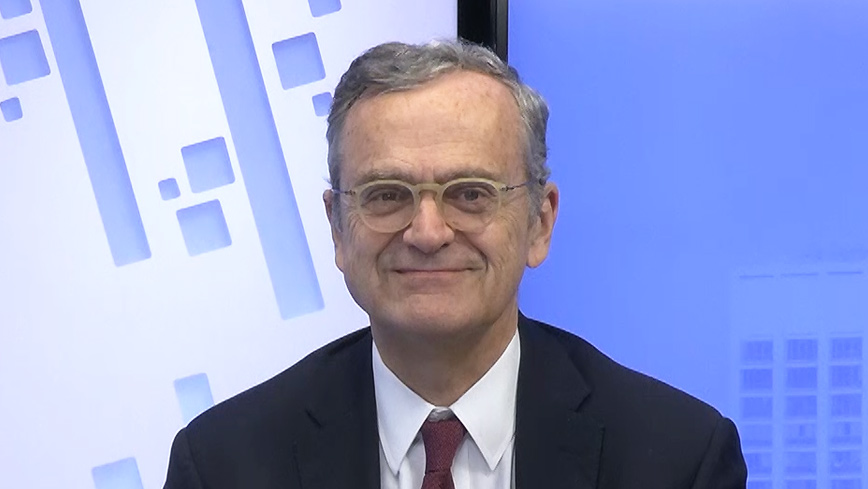


LES INCONTOURNABLES