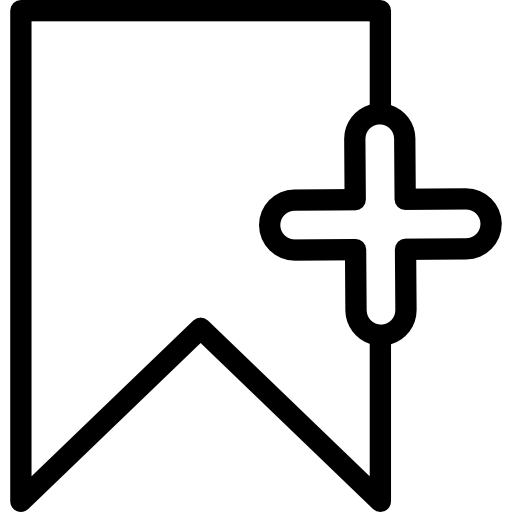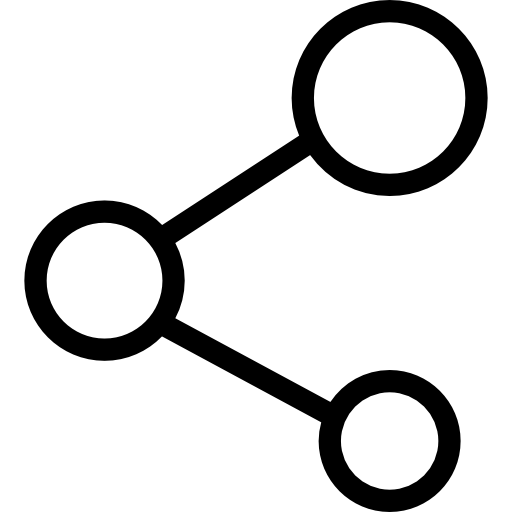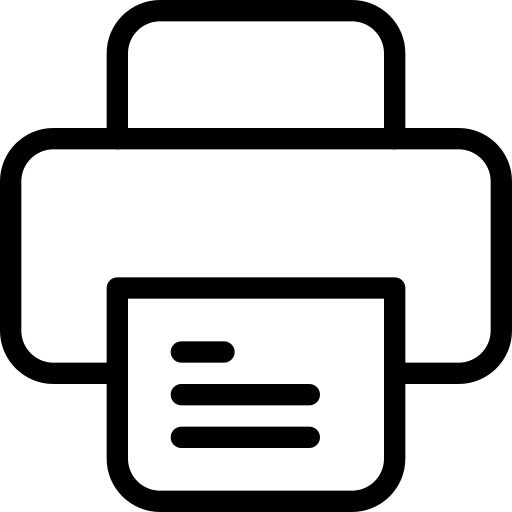Qui coute le plus cher au budget de l’État : les pauvres ou les rentiers? La question peut sembler incongrue. Si par rentier on entend la composante de la population disposant d’importants revenus issus de leur patrimoine, il ne fait pas de doute dans un système fiscal fortement redistributif comme celui de la France, que ces derniers contribuent bien davantage et bénéficient de transferts bien moindres que les plus pauvres.
Et même si l’on fait abstraction de la contribution inégale aux recettes de l’État de ces deux catégories pour ne se pencher que sur le volet des dépenses, il n’y a pas photo dans le PLF 2023 : d’un côté près de 5 milliards de dépenses fiscales pour soutenir l’épargne, et de l’ordre de 10 milliards en appui de l’investissement immobilier et de la rénovation. Et même si l’on tient compte de la réforme de l’IFI et de la flat taxe sur les revenus du capital, la somme est majorée de moins de 4 milliards. Quant aux coûts de la recapitalisation ou des banques après 2008, où de l’État garant du système financier, ils sont quasi nuls. Les prêts à long terme ont été remboursés sans perte et les garanties n’ont pratiquement pas été activées. De l’autre plus de 32 milliards destinés aux principaux minimas sociaux + 11 milliards dédiés à la prime d’activité, soit plus de 43 milliards. Et si l’on ajoute les prestations chômages, les aides au logement et d’autres petits dispositifs, la facture avoisine alors 135 milliards.
Le match est beaucoup plus ouvert lorsque l’on s’interroge sur la destination des fonds publics depuis la crise de 2008. Depuis cette date, l’endettement public a fait un bond de 47 points de PIB, pour maintenir à flot l’économie réelle contre les vents contraires d’une finance en faillite en 2008, d’une crise sanitaire paralysante et d’une crise énergétique et géopolitique. Ce faisant, l’État a évité la paupérisation du pays tout entier, diluant le coût de ces chocs sur plusieurs générations. Mais cette interprétation est trop courte. D’où vient ce zèle des gouvernements de tous bords à se convertir en keynésiens de l’extrême ? Le font-ils d’abord pour protéger les revenus courants des individus et limité la pauvreté d’une minorité, ou pour protéger nos économies d’un effondrement patrimonial ? Les gouvernements vivent en fait sous deux menaces de poids inégal. Celui de la dégradation des revenus courants inhérents aux crises, avec des effets conjoncturels et sociaux circonscrits et celui d’un effondrement des prix d’actifs susceptibles d’emporter tout le système dans une déferlante financière incontrôlable, risquant de ruiner grands et petits épargnants et de paralyser tout le circuit de financement de l’économie. Ne ménageant pas leurs efforts, les gouvernements sont parvenus jusqu’ici à éviter cette grande culbute. Faisant mieux que maintenir en apesanteur les prix d’actifs, ce sont in fine les plus riches, ceux qui concentrent la richesse, qui sortent gagnant des trois séismes qui ont ébranlé nos économies.
D’un côté, le gouvernement a fait beaucoup en faveur du capital depuis 15 ans : baisse des cotisations employeur, de l’IS, des impôts sur la production, flat taxe sur les revenus du patrimoine, réforme de l’IFI … avec pour priorité protéger les revenus du capital et du patrimoine des assauts de la conjoncture.
Sur l’autre versant, celui de la pauvreté, il n’est pas en reste non plus. Avec plusieurs mesures phares. De la mise en place de la prime d’activité en 2016, mainte fois revalorisée, au bouclier et divers chèques anti inflation, en passant par la massification du chômage partiel lors de la crise sanitaire. Mais deux constats doivent être fait. 1/ Lorsque l’on se centre sur les principaux minimas dédiés à la lutte contre la pauvreté et l’inclusion, l’augmentation de la charge doit-être relativisée. Idem d’ailleurs lorsque l’on agrège plus largement toutes les dépenses de l’État ciblées sur les plus pauvres (aide au logement, chômage, survie, exclusion sociale). Il n’y pas de changement de régime palpable et le pic de 2020 ressemble à une embardée temporaire 2/ Lorsque l’État cofinance les travailleurs pauvres, ou qu’il recoure au chômage partiel, il décharge les entreprises de coûts qui leurs sont imputables et sanctuarise de fait leurs débouchés et leurs profits. Mutualisant les pertes potentielles du système productif, le quoi qu’il en coute est plus qu’ambivalent. Derrière son masque social, il protège le capital et la rente financière.
Et derrière les 47 points de dette supplémentaire depuis 2007, seuls 4,1 sont imputables aux déficits des régimes sociaux stricto-sensu. Le reste relève des baisses d’impôt, notamment sur les entreprises et de l’empilement des dispositifs contra-cycliques financés à découverts. Prenant à sa charge une part croissante du revenu des ménages, l’État a limité la casse sociale, mais préservé aussi de la sorte les revenus du capital, la valeur des actifs et in fine les rentiers, ces derniers étant exposés à des risques de perte bien plus considérable que les plus pauvres.
In fine depuis 15 ans, l’État dépense sans compter pour protéger les intérêts liés du travail et du capital, des pauvres et des riches, dans un capitalisme financiarisé où, si les premiers de cordée décrochent, ils embarquent dans leur chute la société dans son ensemble.
Publié le lundi 19 juin 2023 . 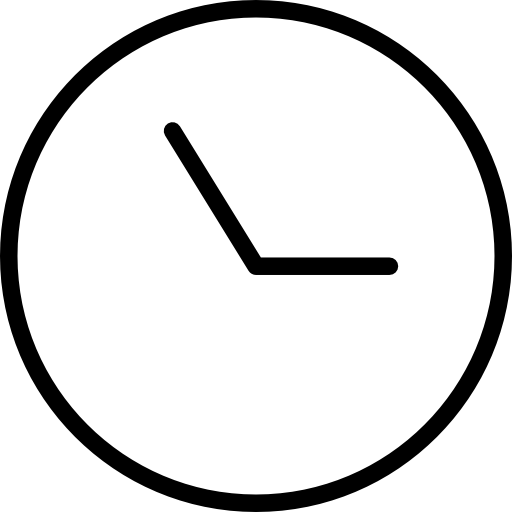 5 min. 39
5 min. 39
Les dernières vidéos
Politique économique


Les dernières vidéos
d'Olivier Passet

LES + RÉCENTES
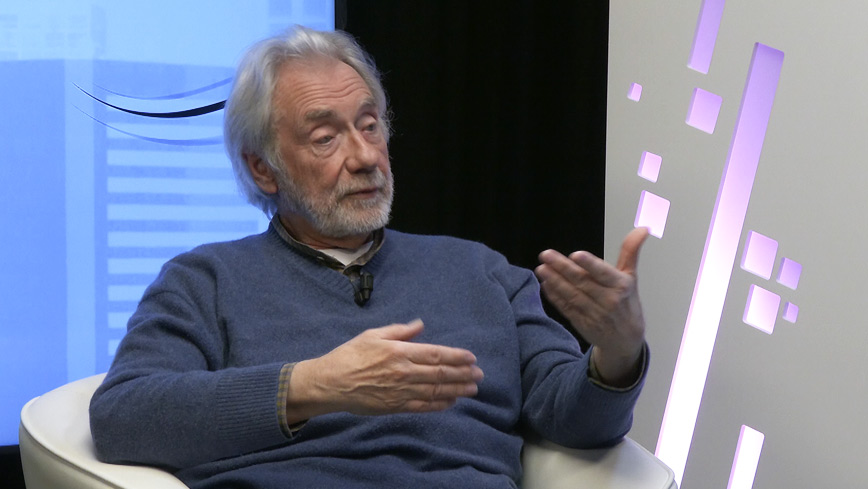



LES INCONTOURNABLES