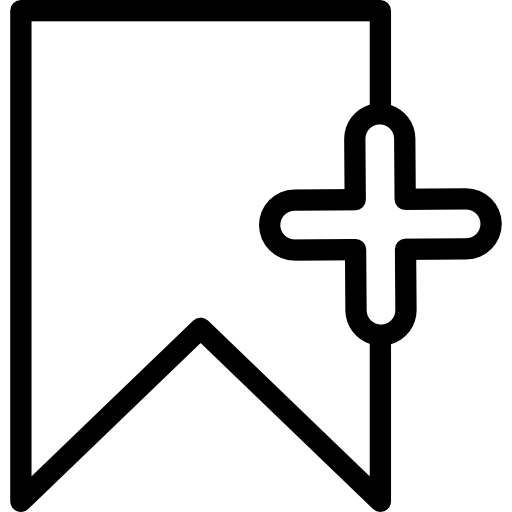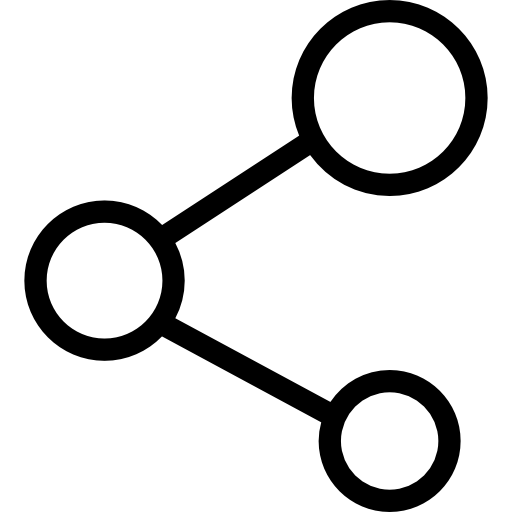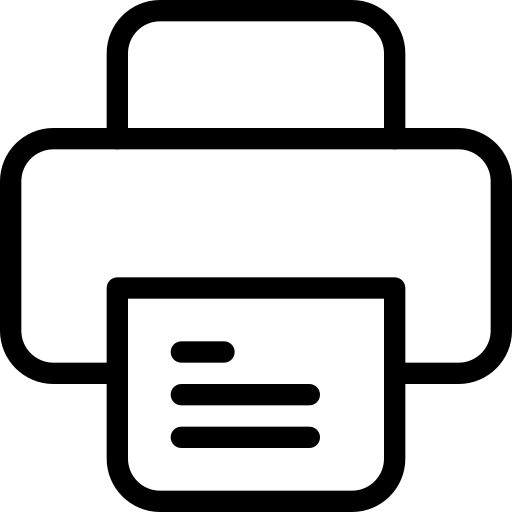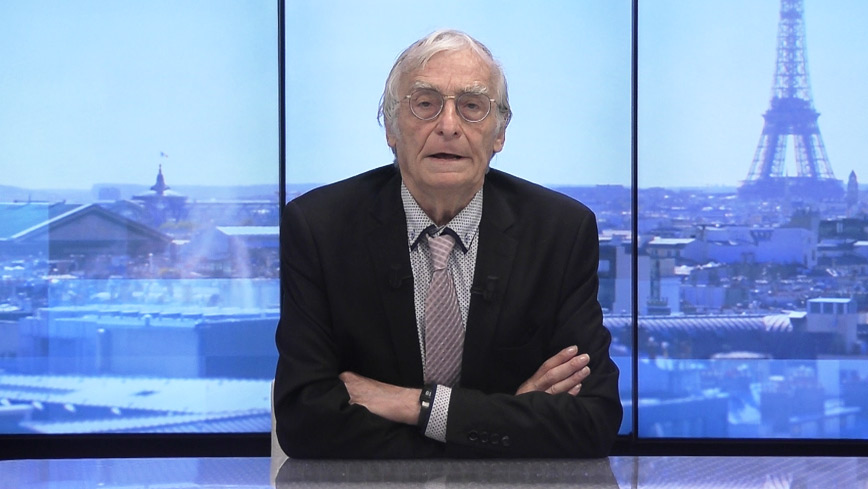Les défis et perspectives des sociétés de recherche sous contrat (CROs) d’ici 2022
Publié le mardi 10 mars 2020 .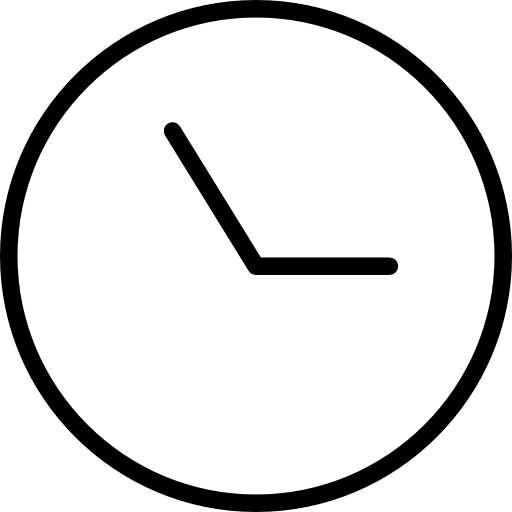 3 min. 23
3 min. 23
Les sociétés de recherche sous contrat implantées en France ont le vent en poupe. Leur activité s’est accélérée en 2018 et 2019 selon l’étude Xerfi-Precepta. Elles ont profité de fondamentaux solides, comme la hausse des dépenses de R&D des laboratoires pharmaceutiques ou l’externalisation croissante des essais cliniques. Les CROs françaises ont également bénéficié de leur expertise reconnue mondialement en oncologie, une aire thérapeutique qui occupe une place croissante dans les pipelines pharmaceutiques. Surtout, les avancées réglementaires adoptées récemment comme les dispositifs « Fast Track » ou la réforme de la désignation des Comités de Protection des Personnes ou CPP ont permis à la recherche clinique tricolore de revenir progressivement sur le devant de la scène. D’autres bouleversements législatifs, à l’échelle européenne cette fois, devraient soutenir la recherche clinique hexagonale à court et moyen termes à l’instar du règlement européen sur les dispositifs médicaux ou celui sur les essais de médicaments à usage humain.
Mais l’embellie pourrait être de courte durée. La France continue en effet de perdre du terrain sur les phases précoces, pourtant cruciales. Et alors que l’ouverture des bases de données médicales s’accélère, comme en témoigne le lancement du Health Data Hub fin 2019, les grandes CROs anglo-saxonnes apparaissent les mieux armées pour tirer profit de cette évolution. Fortes de leurs stratégies full service et d’acquisitions régulières, à l’image de celle de Medimix International par PPD, elles disposent de compétences toujours plus pointues dans l’analyse et le traitement de données de santé. La concurrence se renforce également avec les centres de recherche ou les cliniques qui pénètrent peu à peu le marché français de la recherche sous contrat.
Dans ce contexte, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les CROs ? La course à la taille apparaît sans doute comme le levier le plus radical afin de gagner en visibilité auprès des grands donneurs d’ordres, bénéficier d’économies d’échelle et d’effets d’expérience et faire face à des investissements de plus en plus coûteux. Les CROs améliorent en parallèle leur efficacité opérationnelle. Pour réduire les délais de développement des médicaments, elles investissent dans l’intelligence artificielle avec en ligne de mire l’optimisation des processus de recrutement des participants et des différentes étapes de réalisation des essais cliniques. Au-delà de ces logiques, les acteurs explorent aussi de nouveaux horizons. Par exemple en élargissant leur champ de compétences via l’acquisition de sociétés spécialisées ou, au contraire, en se focalisant sur un domaine thérapeutique précis ou un stade de recherche. Ces acteurs de niche entendent ainsi développer une expertise différenciante, difficilement accessible aux leaders mondiaux et capter des contrats à forte valeur ajoutée. Leur expertise suscite d’ailleurs les convoitises des géants mondiaux. Les plus grandes CROs s’attellent pour leur part à diversifier leurs marchés clients en s’adressant aux industries des dispositifs médicaux, des cosmétiques ou des biotechnologies.
D'APRÈS L'ÉTUDE:
Precepta Les défis et perspectives des sociétés de recherche sous contrat (CROs) d’ici 2022 4ème trimestre 2019Les dernières vidéos
Santé
Les dernières vidéos
d'Alexandre Boulègue

LES + RÉCENTES
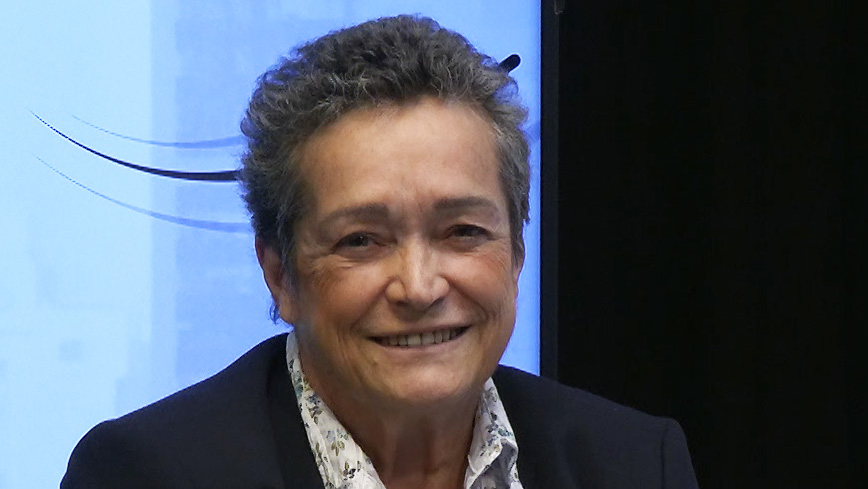

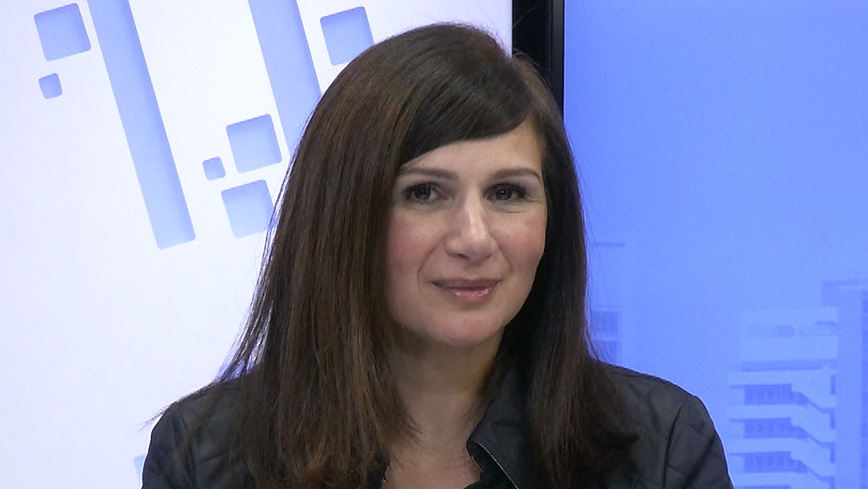
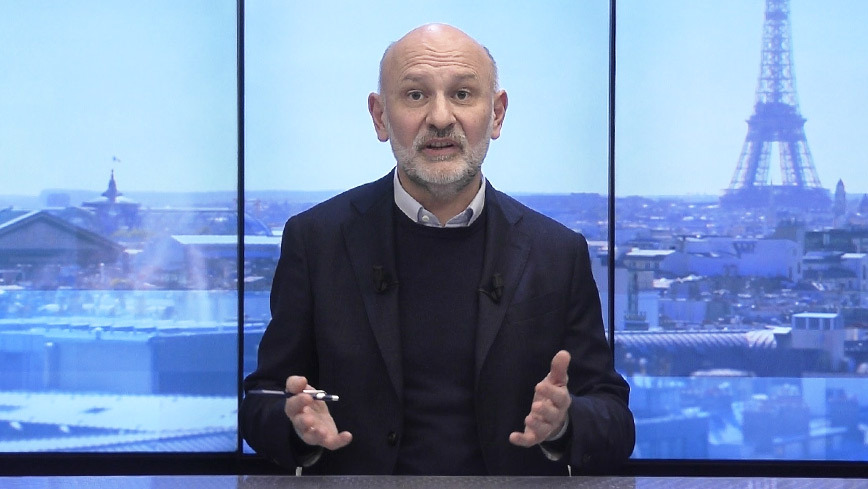
LES INCONTOURNABLES

-6494.jpg)



-d-ici-2022-306346689.jpg)