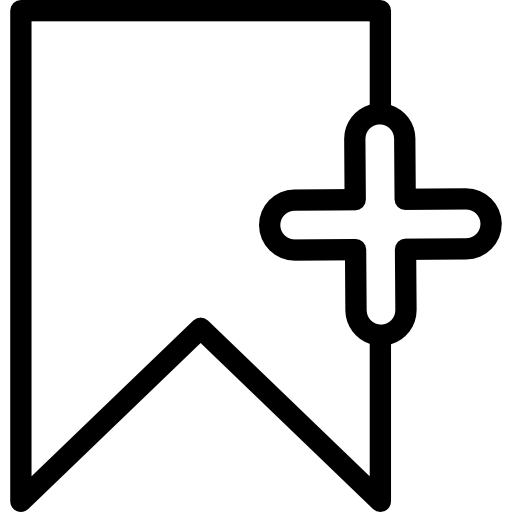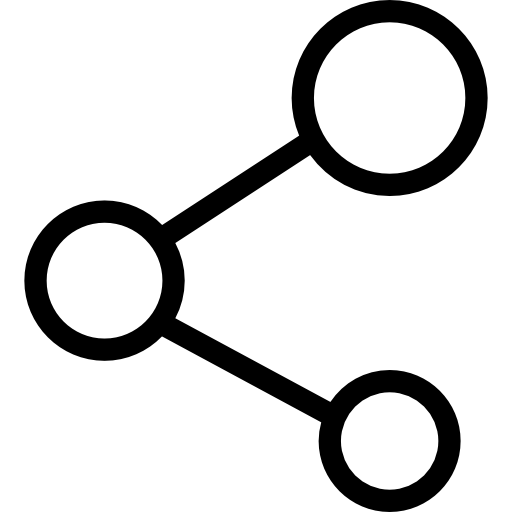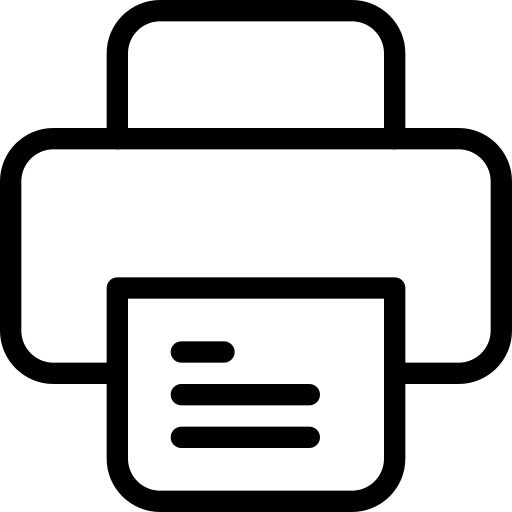Il y a des notions économiques qui paraissent intuitives au premier abord. Y = I + C en économie fermée. C’est la première équation comptable que l’on apprend. La production d’un pays est soit consommée, soit investie. Ces notions semblent pouvoir se passer de définition. Ce qui est produit sert soit à satisfaire les besoins immédiats des ménages, soit à être mobilisé dans la durée pour réaliser une production. Il y a donc d’un côté des produits éphémères ayant vocation à être détruits, recouvrant les dépenses courantes d’objets et services du quotidien. Et de l’autre, des produits plus coûteux, dont on espère un retour sur investissement sur un horizon long : tout ce qui est dur et s’amortit dans la durée — les logements, les infrastructures, les bâtiments commerciaux et industriels, les machines, et dont le financement peut s’opérer par de l’endettement. La partition coule de source.
Une histoire de conventions
Les choses deviennent déjà plus compliquées lorsque l’on prend en considération les biens durables, ceux dont la durée de vie dépasse l’année. Après tout, si le logement est compté en investissement, c’est au nom du service qu’il rend aux ménages considéré comme une autoproduction de service immobilier des ménages propriétaires. Quid alors des véhicules particuliers, de l’équipement ménager, du matériel informatique audio, photographique ? On pourrait associer à chacun de ces biens un service rendu dans la durée, entrant dans l’autoproduction domestique et reclasser ces biens en investissement. Ce n’est pas le choix de la comptabilité nationale qui a une conception limitative de la production domestique et classe donc tous ces biens dans le périmètre de la consommation. Première convention, premier arbitraire, notamment dans une économie digitale qui fait pourtant de nous des coproducteurs.
Les choses deviennent carrément plus complexes lorsque l’on aborde la composante immatérielle de l’investissement. Comment traiter les dépenses de conseil, d’études, de marketing, de publicité, d’ingénierie, de design, l’acquisition de bases de données ou de droits attachés à l’exploitation d’une œuvre ou d’une innovation ? Toutes ces dépenses associées à l’économie de la création contribuent à renforcer le capital intellectuel. Ces services ont un caractère durable, leur permettant d’être utilisés de façon récurrente dans la production, contribuant au renforcement de la marque, des parts de marché, de l’efficacité et des capacités de l’entreprise. Idem pour les dépenses de formation qui ont vocation à renforcer le capital humain. Et l’on peut encore étendre cette question au périmètre des dépenses d’investissement de l’État : les dépenses d’éducation, de santé notamment, voire de sécurité. Ces dépenses infusent leurs effets dans la durée. Renforçant les compétences, le potentiel d’innovation, la mobilité sociale, la santé, et avec elle la durée de consommation, de production, de contribution fiscale des individus. On pourrait aussi s’interroger sur le traitement de l’investissement direct, considérées comme des opérations financières sur le reste du monde, mais qui accroissent les économies d’échelle, le pouvoir de marché et de réseau des entités résidentes.
Le taux d’investissement productif ne diminue pas sur le long terme
Face à ces questionnements, la comptabilité nationale n’est pas restée inerte. Depuis quelques années, la FBCF se dématérialise, incorporant les dépenses liées à l’achat de logiciels, les œuvres littéraires et artistiques originales et plus récemment les dépenses de recherche-développement, de bases de données. Par contre, les dépenses de formation continue, de conseil ou de publicité restent comptabilisées comme des dépenses de consommations intermédiaires. Les dépenses liées à la formation initiale ou à la santé sont considérées comme une consommation finale collective des ménages. Or, ces conventions, ces changements de périmètres créent une très forte incertitude autour des problématiques lancinantes du sous-investissement chronique de nos économies et de la panne de productivité.
Cet abord élargi, de l’investissement immatériel, même s’il reste partiel, est déjà riche d’enseignement. Il montre à quel point les forces motrices de nos économies ont changé de nature, et à quel point aussi, certaines thématiques qui ont envahi le débat économique dans les années 80 et 90, autour de la baisse inexorable du taux d’investissement, étaient victimes d’un abord trop matériel de l’investissement. Ce qui frappe d’abord, c’est la puissance de la recomposition du capital, avec une baisse de la part consacrée au logement et aux bâtiments et une montée concomitante de la part allouée aux machines et à l’immatériel. Cette modération de l’effort consacré aux structures, normal dans une économie arrivée à maturité et ayant achevé sa reconstruction, contribue largement au ralentissement du stock de capital qui nous inquiète. Mais pris dans sa globalité, le taux d’investissement productif n’a pas diminué sur le long terme, et le taux d’investissement, alloué aux équipements et à l’immatériel progresse tendanciellement, loin de l’idée d’une préférence pour le capital improductif.
Ces constats lapidaires montrent à quel point le débat de la dette repose sur des sables mouvants. Les acteurs publics et privés engagent une proportion croissante de leur budget sur des investissements immatériels à rendement différé, non reconnus comme tels. Or, c’est à l’aune de ces dépenses et de leur rendement que l’on peut juger du caractère excessif ou non d’un endettement.
Publié le mercredi 7 juillet 2021 . 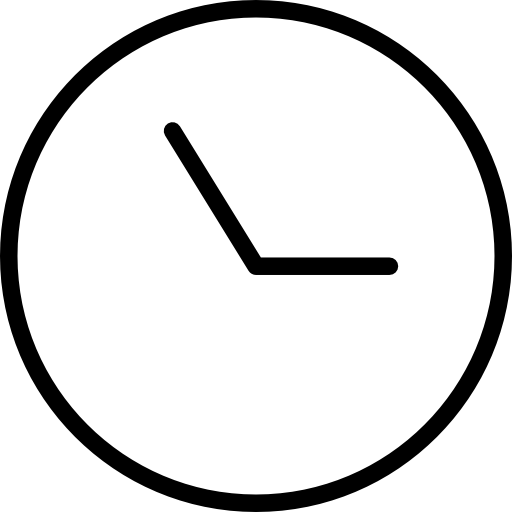 5 min. 50
5 min. 50
Les dernières vidéos
Économie générale



Les dernières vidéos
d'Olivier Passet

LES + RÉCENTES
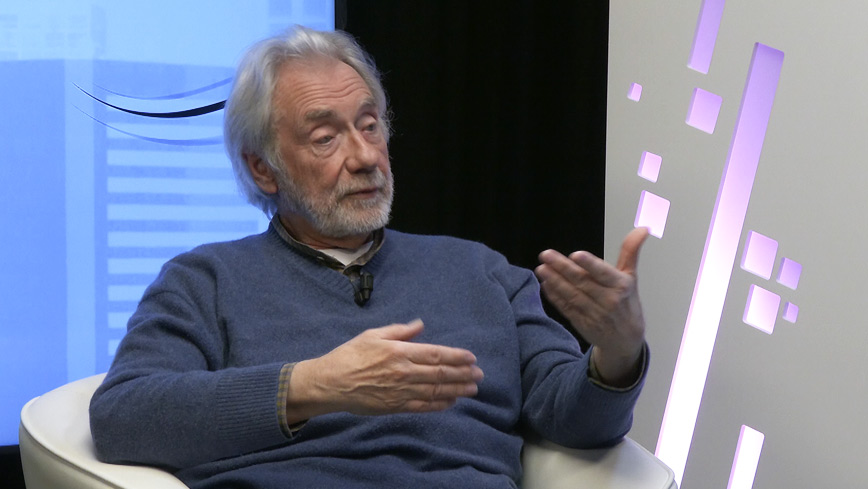



LES INCONTOURNABLES