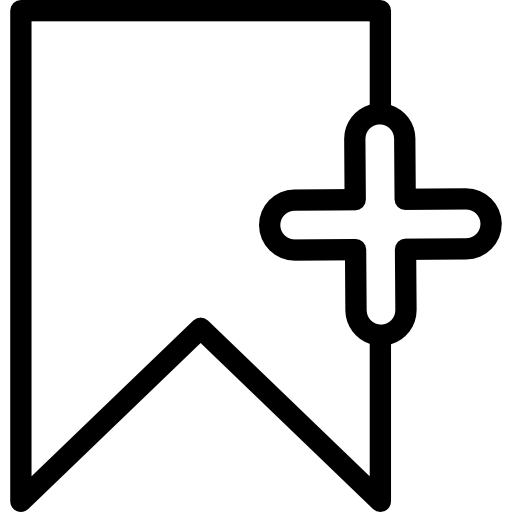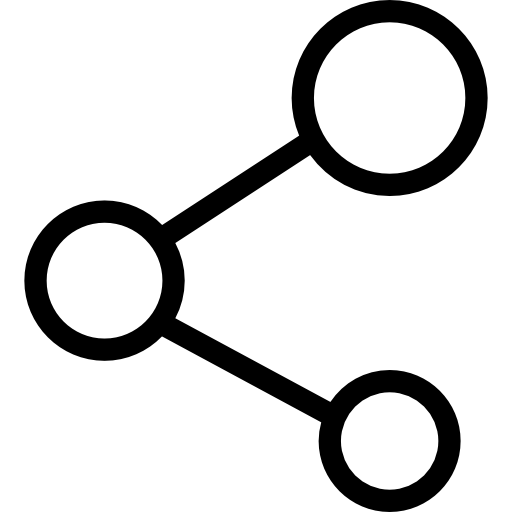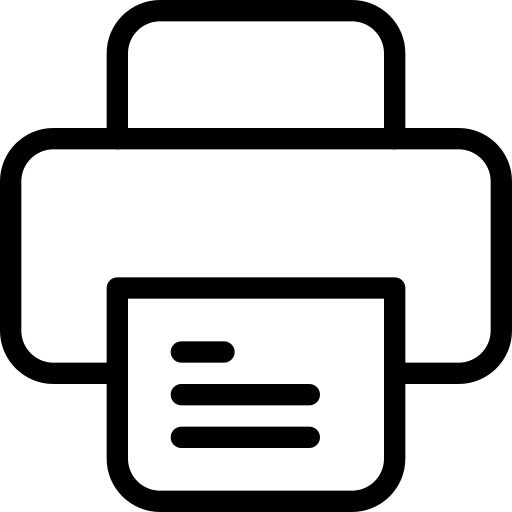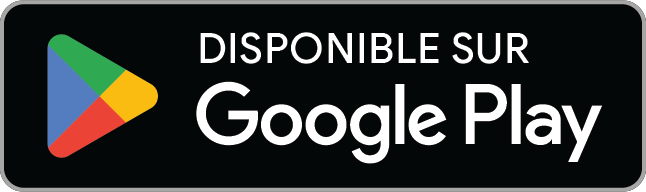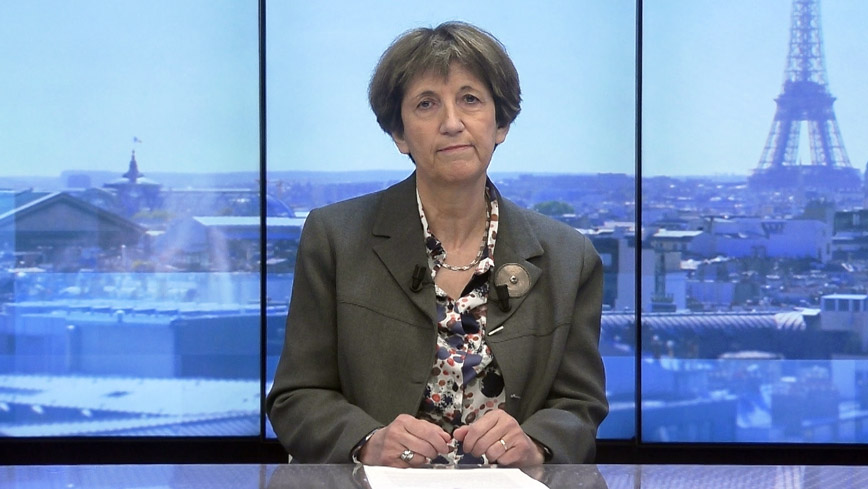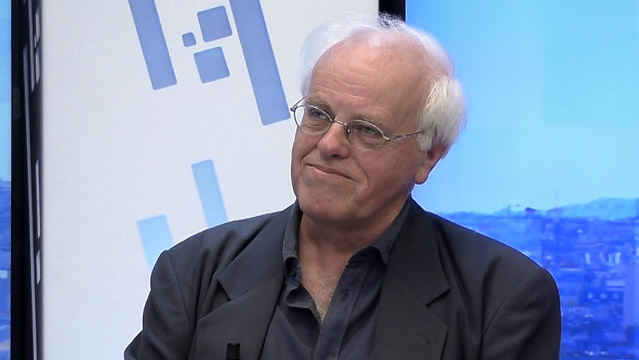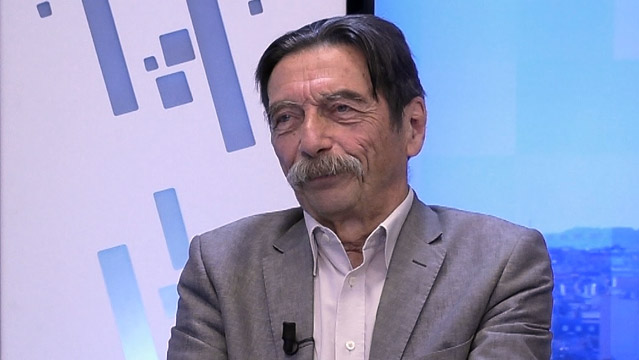Dans son numéro spécial sorti à l’automne dernier, la Chronique internationale de l’IRES revient sur les mobilisations sanitaires des États et de l’Union européenne face à la première vague de Covid-19 du printemps 2020.
Composé de neuf monographies nationales et d’une contribution sur l’Union européenne, le numéro compare les interventions des États sur les systèmes de santé face à l’épidémie. La question qu’il soulève est celle de leur degré de ressemblance et de l’influence de l’agencement spécifique des institutions sanitaires sur les réponses étatiques.
Les articles du numéro font d’abord ressortir les similitudes des interventions des États, bien qu’elles ne soient pas coordonnées par des institutions supranationales ou multilatérales, l’Union européenne en particulier n’ayant ni les compétences ni les moyens pour s’imposer comme un acteur incontournable. Dans la plupart des cas étudiés, on observe des mesures de restriction des déplacements et de confinement pour réduire l’incidence du virus et protéger l’accès aux soins des malades, un accroissement des capacités d’accueil des hôpitaux et de leur encadrement soignant ou encore des achats centralisés d’équipements de protection individuelle. Ces ressemblances peuvent s’expliquer par l’incertitude scientifique et politique de la crise sanitaire qui semble avoir favorisé la circulation par mimétisme de certaines solutions depuis la Chine jusqu’aux pays européens, comme celle du confinement. Ces similitudes tiennent aussi à des tendances convergentes des politiques de santé qui contraignent l’action des gouvernants face à l’épidémie. On pense notamment à la dérive des outils de préparation au risque pandémique et à la réduction du nombre de lits hospitaliers sous l’effet de réformes des systèmes de santé.
Si les États adoptent des recettes communes dans la gestion sanitaire de la crise, leur mise en œuvre est cependant susceptible de varier en fonction de l’agencement institutionnel des États et de leur système de santé. Cela est manifeste dans les opérations de coordination des hôpitaux et de répartition des patients qui peuvent être orchestrées par les autorités publiques, locales ou centrales, comme en Angleterre ou par des organisations professionnelles comme en Allemagne. Par ailleurs, les stratégies sanitaires des États peuvent présenter des originalités qui sont liées à l’architecture de leur système de santé et aux opportunités d’action qu’elle offre. C’est ce que montre l’intégration des soins primaires dans les politiques d’urgence sanitaire là où la régulation publique de ces soins est plus poussée, comme en Suède et dans la région italienne de Vénétie. Enfin, des problèmes liés aux spécificités des différents systèmes de santé peuvent émerger au cours de l’épidémie et appeler des interventions publiques particulières. Cela est illustré par la question de l’accès financier au dépistage et aux soins qui est uniquement posée dans les systèmes fondés sur des assurances, sociales ou privées, comme en France et aux États-Unis.
En somme, les autorités publiques mobilisent dans leur réponse à la crise du Covid-19 des recettes communes mais qui sont reconfigurées par les logiques institutionnelles des États et de leur système de santé. En effet, on observe des stratégies sanitaires nationales plus singulières qu’il n’y paraît. Elles semblent d’ailleurs suivre des trajectoires spécifiques avec l’émergence de l’enjeu vaccinal et l’inscription dans la durée de la pandémie.
Publié le mercredi 12 mai 2021 . 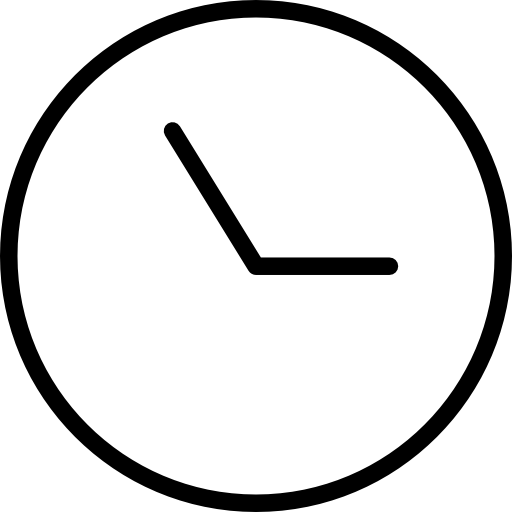 4 min. 02
4 min. 02
Les dernières vidéos
Santé
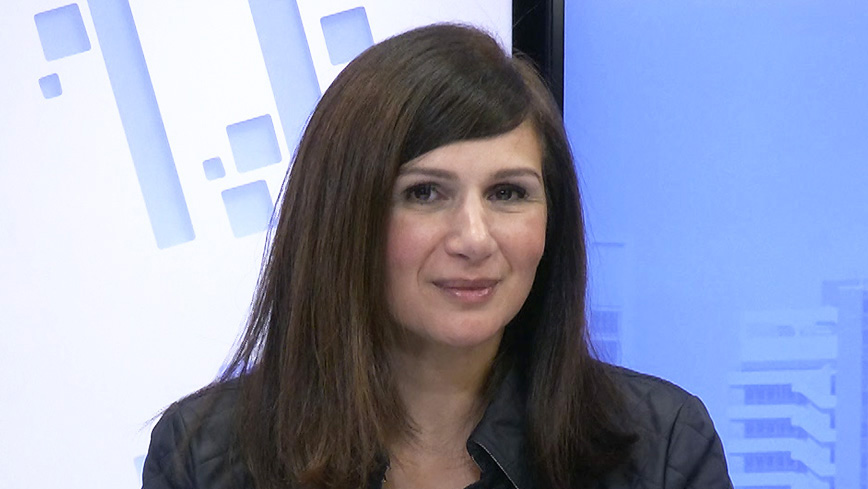


-innover-face-a-la-pression-des-laboratoires-306351327.jpg)
Les dernières vidéos
d'Ires
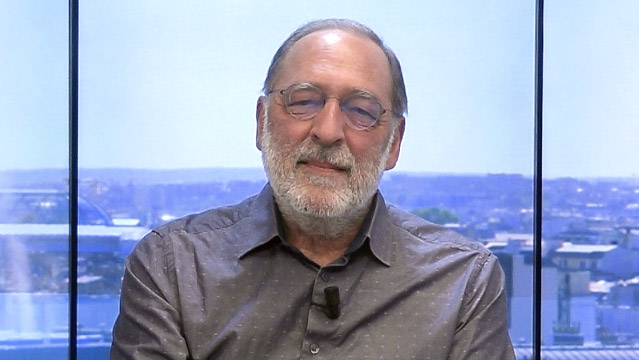
LES + RÉCENTES
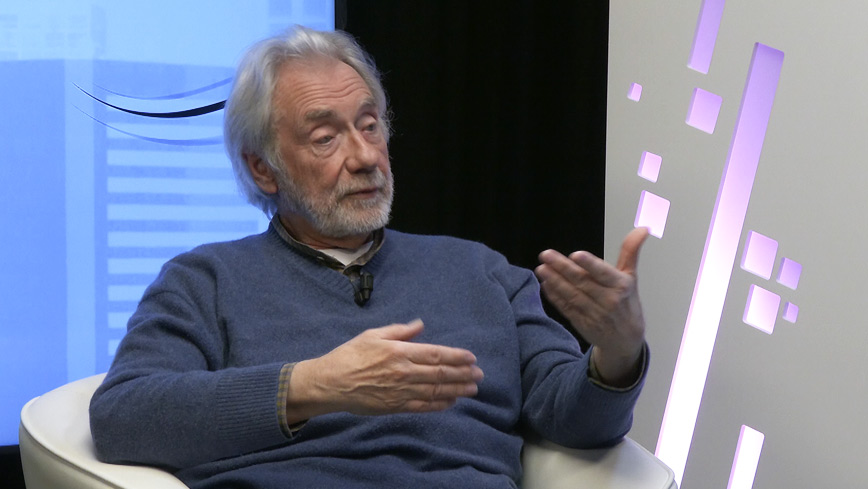
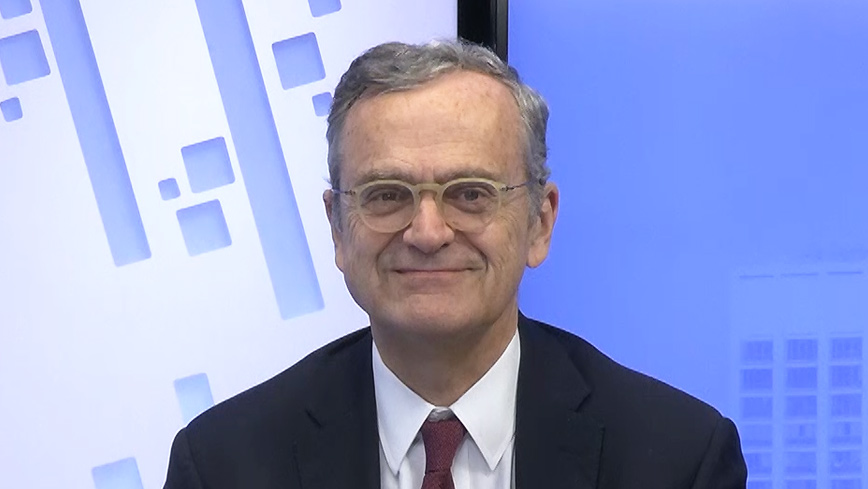


LES INCONTOURNABLES