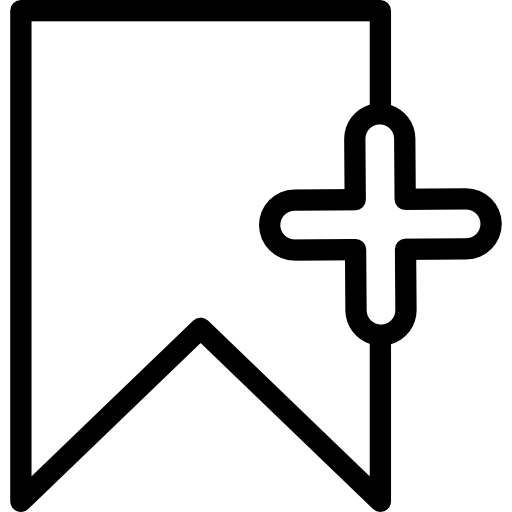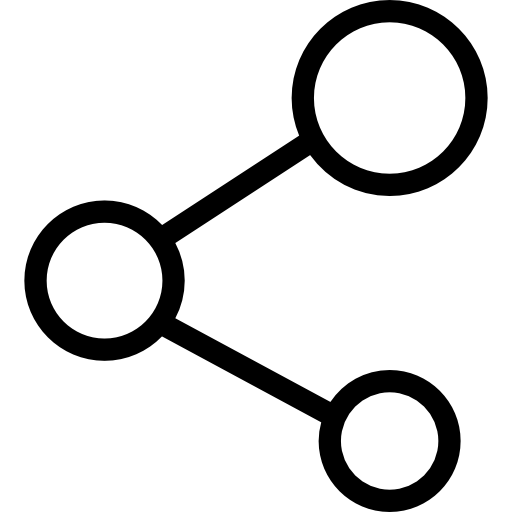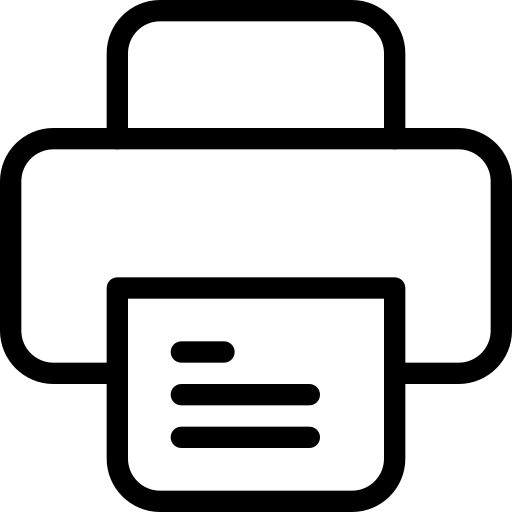Lafarge Holcim, Publicis Omnicom, Nokia Alcatel-Lucent, Fnac Darty, Alstom General Electric. Les médias économiques se font régulièrement l’écho de vastes opérations de fusions acquisitions, amicales ou hostiles. Ces opérations semblent constituer une manœuvre stratégique privilégiée pour de nombreuses entreprises à la recherche d’une consolidation de leur industrie, d’économies d’échelle ou d’une diversification à bon compte. Pourtant, les choses ne sont pas si simples.
Tout d’abord, curieusement, il n’est pas évident de distinguer les fusions des acquisitions. Certaines opérations sont ainsi officiellement présentées comme des fusions, alors qu’elles se révèlent en fait être des acquisitions. C’est notamment ce qui a fait échouer le rapprochement entre Publicis et Omnicom. D’autres sont des acquisitions, mais qui ne sont pas suivies d’une fusion, comme dans le cas de Renault Nissan ou de Air France KLM. Cette impossibilité de distinguer fusions et acquisitions fait qu’on a pris l’habitude de les désigner sous le vocable générique « fusions acquisitions », abrégé en fusaqs dans le jargon fleuri des banquiers d’affaires.
Cependant, le plus perturbant dans les fusions acquisitions, c’est que la vaste majorité d’entre elles sont des échecs. On mesure généralement le succès de ce type d’opérations à l’aide de deux critères : un critère financier (est-ce que les actionnaires de l’acheteur ont vu la valeur de leur investissement augmenter ?), et un critère commercial (est-ce que la part de marché du nouvel ensemble est supérieure à la somme des deux parts de marché précédentes ?). Or, d’après les nombreux travaux de recherche consacrés au sujet, de 60 à 75 % des opérations de fusions acquisitions sont des échecs. Souvent, les actionnaires de l’acheteur doivent surenchérir pour acquérir leur cible, ce qui les expose à ce qu’on appelle la malédiction du vainqueur : on emporte la bataille pour le contrôle, mais on paye beaucoup trop cher. Tout aussi souvent, les équipes des deux entreprises sont perturbées par le rapprochement, et toute l’énergie passée à rendre compatibles les deux cultures se traduit par une érosion des positions commerciales. Au total, les fusions acquisitions sont ainsi très majoritairement ratées. Dans ces conditions, pourquoi voit-on encore de si nombreuses opérations de fusions acquisitions ? Trois raisons expliquent cette apparente anomalie.
Tout d’abord, les fusions acquisitions sont quelquefois la seule manière pour un acheteur d’acquérir des ressources ou des compétences trop éloignées de son cœur de métier. C’est par exemple ce qui peut expliquer le rachat de Nokia par Microsoft. C’est une opération risquée, mais il n’y avait pas vraiment d’alternative.
La deuxième raison est psychologique : les banquiers d’affaires, rémunérés au pourcentage de l’opération, n’ont pas de peine à convaincre les dirigeants que s’ils ne deviennent pas acquéreurs, ils pourraient très bien devenir cibles, au péril de leur poste.
La troisième raison est purement politique. En l’absence de véritable stratégie, se lancer dans une fusion acquisition peut donner l’illusion qu’on est un grand stratège. L’opération provoquera un tel maelstrom dans l’entreprise que le temps qu’on se rende compte de ses retombées, on aura oublié que la stratégie faisait défaut. Heureusement, ces opérations cache-misère, si elles existent, ne sont pas les plus fréquentes. Et elles ne remplacent jamais une véritable stratégie.
Publié le mardi 26 janvier 2016 . 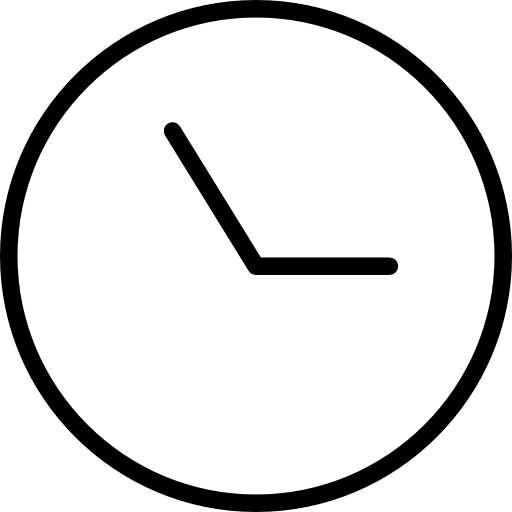 3 min. 46
3 min. 46
Les dernières vidéos
Stratégie



Les dernières vidéos
de Frédéric Fréry



LES + RÉCENTES
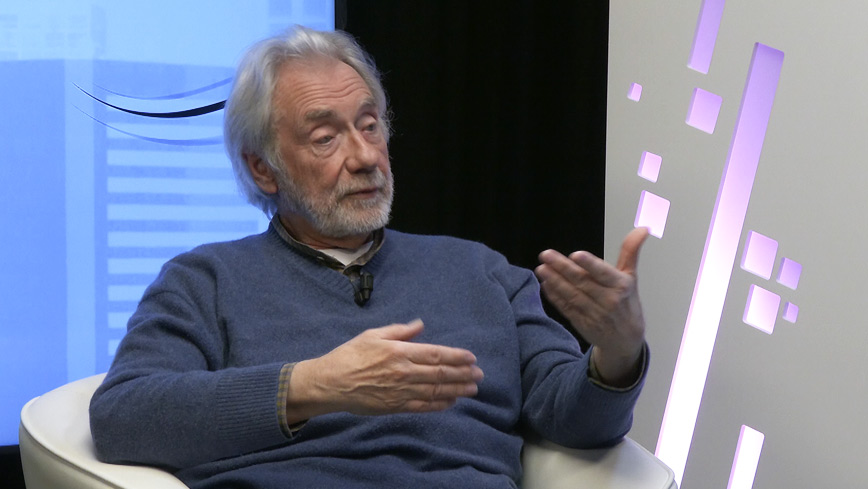



LES INCONTOURNABLES