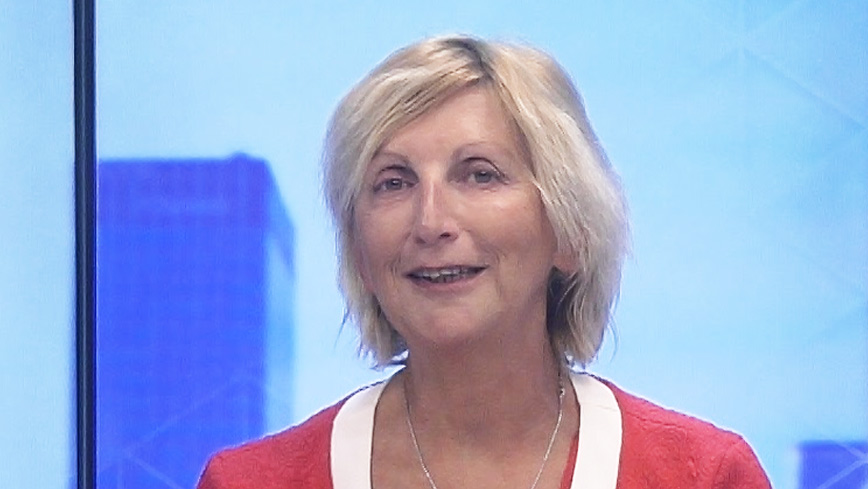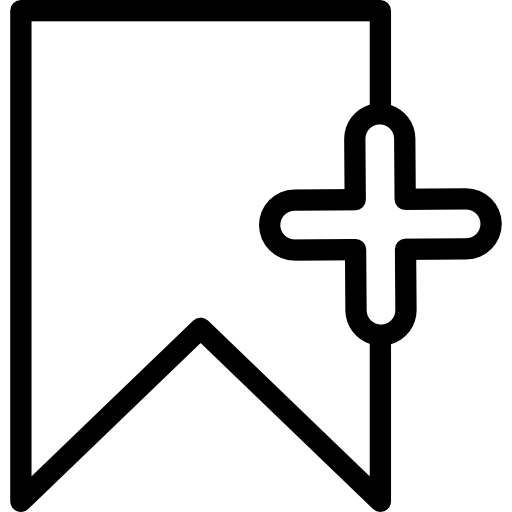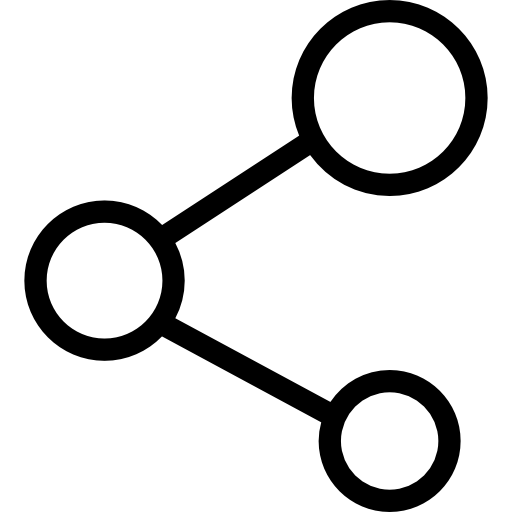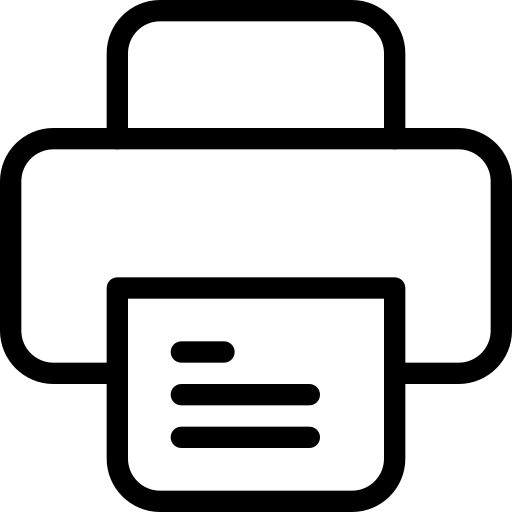On parle beaucoup de changement et de conduite du changement dans les organisations. On en connait les bonnes pratiques.
Or, un constat se fait souvent : quelques semaines ou quelques mois après le changement dument mis en œuvre, il semble que l’organisation revienne à un état qui ressemble beaucoup ou tout à fait à l’état initial.
Les changements semblent oubliés, dilués, avalés par l’entreprise où chacun est revenu à ses anciennes habitudes.
Ce phénomène est décrit dans la littérature par un concept qui nous vient de la physique : l’homéostasie. Selon la définition de Durand dans son livre « La systémique » en 1979, l’homéostasie décrit : « la capacité d’un organisme à conserver l’équilibre de son fonctionnement en dépit des contraintes extérieures ».
Cette propriété a été décrite pour le corps humain par Claude Bernard puis véritablement conceptualisée dans le cadre de la cybernétique.
Mais le concept d’homéostasie est également mobilisé en sciences humaines pour mieux comprendre le fonctionnement des organisations et tout particulièrement la résistance aux changements. Pour ces chercheurs, les organisations sont des systèmes en équilibre qui utilisent, parfois, leurs propres « pathologies » pour se réguler.
Ainsi, Michel Crozier dans le cas de l’agence comptable présentée dans son livre : « Le phénomène bureaucratique » paru en 1963, montre que, si on se place du point de vue des acteurs, la « routine bureaucratique » même perçue comme une pathologie de l’organisation, est pour eux une « solution », un moindre mal qui empêche une menace bien plus grave d’arriver.
Que peut apporter la bureaucratie ? Elle évite les confrontations et les conflits ; elle permet de prendre des décisions sans prise de risque, elle protège aussi les collaborateurs de contrôle tatillons ou d’interventions des supérieurs hiérarchiques.
Ils comprennent bien, nous dit Crozier, que leur façon de travailler ne peut résister aux évolutions du monde extérieur, mais ils préfèrent leur solution plutôt que d’avoir à affronter un changement qui les inquiète.
Ces solutions qu’on peut qualifier de « pathologiques » sont préférées tant qu’elles permettent de préserver la stabilité du système.
Les auteurs évoquent un « consentement tacite », qu’il sera très compliqué de mettre en cause et celui qui s’y emploiera prend le risque de se faire éjecter du système, même si la solution qu’il propose est largement supérieure à celle en cours, comme nous l’explique Gilles Barouch dans son article « Le management du changement à l'épreuve de l'homéostasie des systèmes, « Annales des Mines - Gérer et comprendre » de 2011.
Cette analyse permet de mieux comprendre la difficulté à conduire des changements, même s’ils sont objectivement pour le mieux de l’entreprise et de ses collaborateurs.
La seule issue pour pouvoir prétendre au changement, est que la demande vienne de l’organisation elle-même. Mais il l faut ensuite surmonter un dilemme : en ne changeant pas, l’organisation risque de disparaitre par inadaptation à son environnement. Mais en changeant, elle risque aussi de disparaitre avec la dilution de sa culture. Ce qui explique des situations de non-choix et d’attente, qui peuvent s’assimiler à des résistances.
Il faut alors une belle crise (interne ou externe) pour engager une action de changement. Et rien ne garantit la pérennité de ce changement car revenir à l’équilibre précédent même jugé dysfonctionnel pourra être la solution préférée des acteurs qui constituent l’organisation.
En conclusion, un problème peut être davantage qu’un problème à résoudre. Il peut être la solution trouvée par une organisation pour garder son équilibre dans un environnement instable et incertain.
Sans cette lecture, le changement programmé risque de faire long feu !
Or, un constat se fait souvent : quelques semaines ou quelques mois après le changement dument mis en œuvre, il semble que l’organisation revienne à un état qui ressemble beaucoup ou tout à fait à l’état initial.
Les changements semblent oubliés, dilués, avalés par l’entreprise où chacun est revenu à ses anciennes habitudes.
Ce phénomène est décrit dans la littérature par un concept qui nous vient de la physique : l’homéostasie. Selon la définition de Durand dans son livre « La systémique » en 1979, l’homéostasie décrit : « la capacité d’un organisme à conserver l’équilibre de son fonctionnement en dépit des contraintes extérieures ».
Cette propriété a été décrite pour le corps humain par Claude Bernard puis véritablement conceptualisée dans le cadre de la cybernétique.
Mais le concept d’homéostasie est également mobilisé en sciences humaines pour mieux comprendre le fonctionnement des organisations et tout particulièrement la résistance aux changements. Pour ces chercheurs, les organisations sont des systèmes en équilibre qui utilisent, parfois, leurs propres « pathologies » pour se réguler.
Ainsi, Michel Crozier dans le cas de l’agence comptable présentée dans son livre : « Le phénomène bureaucratique » paru en 1963, montre que, si on se place du point de vue des acteurs, la « routine bureaucratique » même perçue comme une pathologie de l’organisation, est pour eux une « solution », un moindre mal qui empêche une menace bien plus grave d’arriver.
Que peut apporter la bureaucratie ? Elle évite les confrontations et les conflits ; elle permet de prendre des décisions sans prise de risque, elle protège aussi les collaborateurs de contrôle tatillons ou d’interventions des supérieurs hiérarchiques.
Ils comprennent bien, nous dit Crozier, que leur façon de travailler ne peut résister aux évolutions du monde extérieur, mais ils préfèrent leur solution plutôt que d’avoir à affronter un changement qui les inquiète.
Ces solutions qu’on peut qualifier de « pathologiques » sont préférées tant qu’elles permettent de préserver la stabilité du système.
Les auteurs évoquent un « consentement tacite », qu’il sera très compliqué de mettre en cause et celui qui s’y emploiera prend le risque de se faire éjecter du système, même si la solution qu’il propose est largement supérieure à celle en cours, comme nous l’explique Gilles Barouch dans son article « Le management du changement à l'épreuve de l'homéostasie des systèmes, « Annales des Mines - Gérer et comprendre » de 2011.
Cette analyse permet de mieux comprendre la difficulté à conduire des changements, même s’ils sont objectivement pour le mieux de l’entreprise et de ses collaborateurs.
La seule issue pour pouvoir prétendre au changement, est que la demande vienne de l’organisation elle-même. Mais il l faut ensuite surmonter un dilemme : en ne changeant pas, l’organisation risque de disparaitre par inadaptation à son environnement. Mais en changeant, elle risque aussi de disparaitre avec la dilution de sa culture. Ce qui explique des situations de non-choix et d’attente, qui peuvent s’assimiler à des résistances.
Il faut alors une belle crise (interne ou externe) pour engager une action de changement. Et rien ne garantit la pérennité de ce changement car revenir à l’équilibre précédent même jugé dysfonctionnel pourra être la solution préférée des acteurs qui constituent l’organisation.
En conclusion, un problème peut être davantage qu’un problème à résoudre. Il peut être la solution trouvée par une organisation pour garder son équilibre dans un environnement instable et incertain.
Sans cette lecture, le changement programmé risque de faire long feu !
Publié le mercredi 7 décembre 2022 . 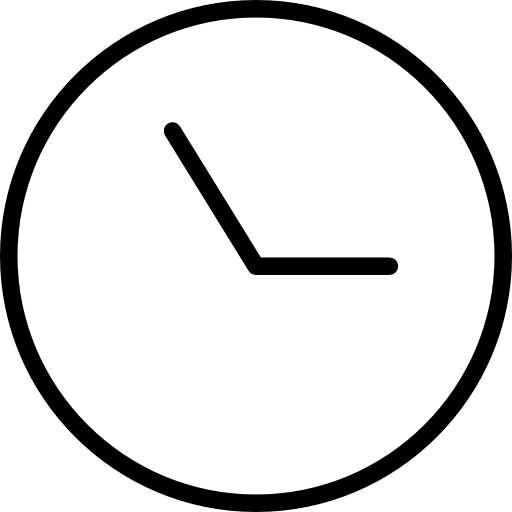 4 min. 15
4 min. 15
Les dernières vidéos
Management et RH
#ffb742
IQSOG - Recherche en gestion
Ressources humaines et éthique du capitalisme ? Eric Godelier
24/07/2024

03:34
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Savoir apprécier les bons côtés de la rigidité Isabelle Barth
23/07/2024

03:50
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Transition écologique des entreprises : les obstacles amont et aval Jérôme Barthélemy
18/07/2024

02:39
Les dernières vidéos
d'Isabelle Barth
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Savoir apprécier les bons côtés de la rigidité Isabelle Barth
23/07/2024

03:50
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Qui doit être le roi : le client ou le collaborateur ? Isabelle Barth
16/07/2024

03:59
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Réapprendre l'insouciance pour reprendre confiance Isabelle Barth
02/07/2024

03:33
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Le désarroi des managers face à la montée des exigences et sollicitations Isabelle Barth
25/06/2024

03:54
LES + RÉCENTES
#ffb742
IQSOG - Recherche en gestion
IA : L’intelligence de la machine a dépassé la nôtre en 1642 Paul Jorion
27/07/2024
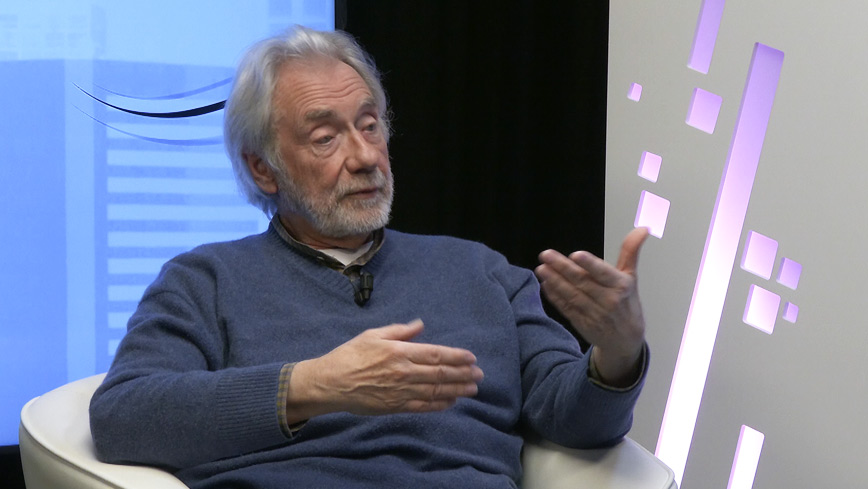
03:32
#ffb742
IQSOG - Recherche en gestion
Réguler et sanctionner les "dérapages" sur les réseaux sociaux et l'audiovisuel Roch-Olivier Maistre
27/07/2024
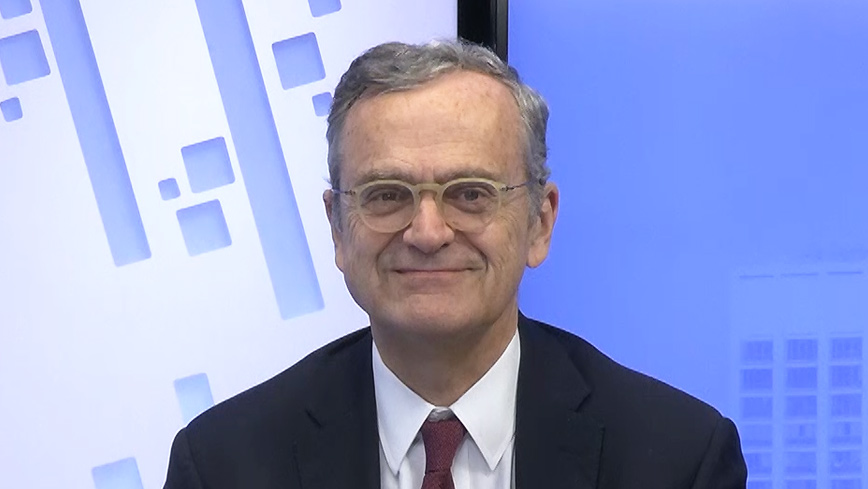
05:29
#66e8e1
ÉCONOMIE
Chat GPT ne fait que refléter la pensée dominante, même sur l'environnement Gilles Rotillon
23/07/2024

04:12
#a544a3
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Savoir apprécier les bons côtés de la rigidité Isabelle Barth
23/07/2024

03:50
LES INCONTOURNABLES
#66e8e1
ÉCONOMIE
La décarbonation en Chine : entre indépendance stratégique et objectifs verts Anaïs Voy-Gillis
09/07/2024

04:49
#66e8e1
ÉCONOMIE
L’IA dans l’énergie : une révolution pour gagner en compétitivité et stimuler sa croissance Alix Merle
05/07/2024

03:45
#66e8e1
ÉCONOMIE
La science économique peut-elle vraiment améliorer la société ? Gilles Rotillon
05/07/2024

04:10