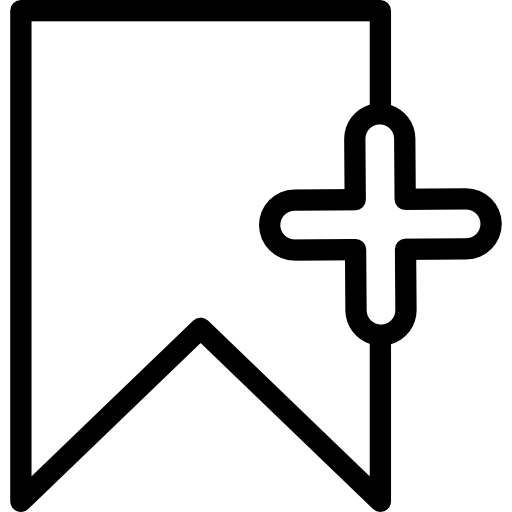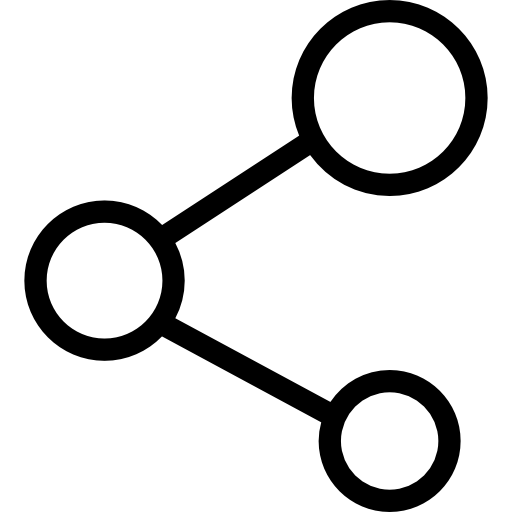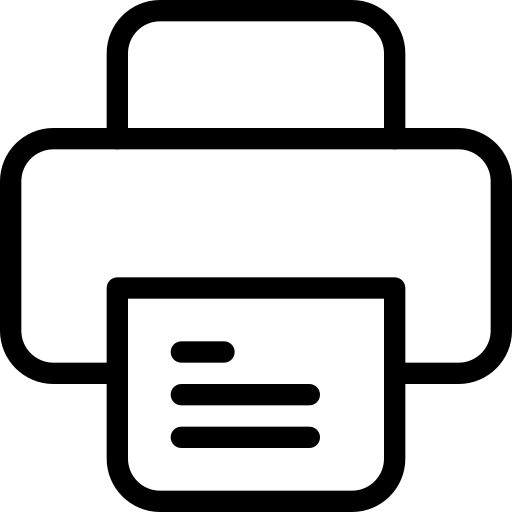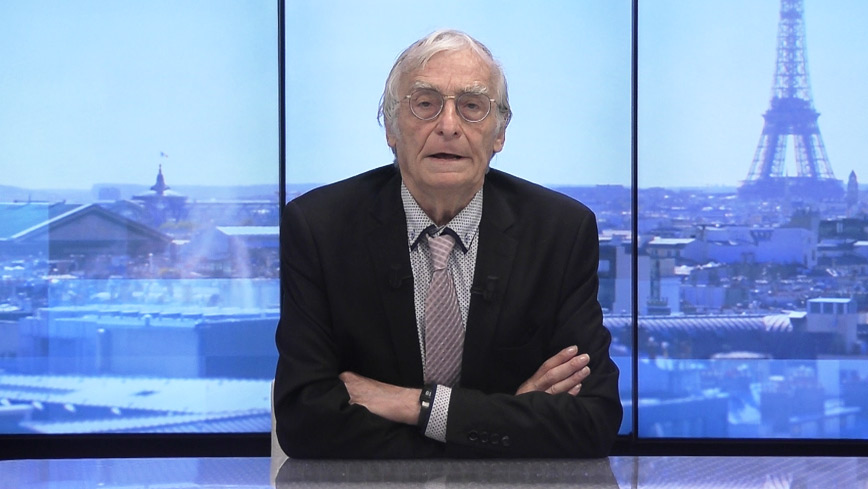Comprendre les stratégies de coopétition
Publié le mercredi 27 mai 2015 .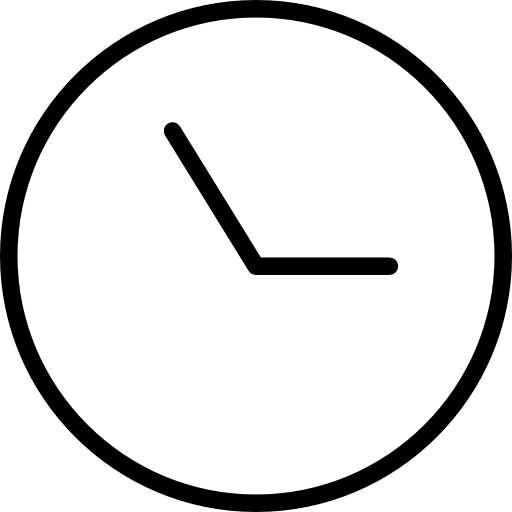 5 min. 00
5 min. 00
La coopétition, c'est une contraction des mots « coopération » et « compétition ». Popularisé par les américains Nalebuff et Brandenburger dans le livre « co-opetition » publié en 1996, ce néologisme décrit une relation de coopération stratégique entre des entreprises qui sont dans le même temps en concurrence sur le marché final. Pour comprendre, il suffit de se rappeler les exemples célèbres de la joint-venture entre Sony et Samsung dédiée au co-développement des écrans LCD, ou encore les accords entre ce même Samsung et Apple concernant la fourniture de composants électroniques pour l’iPhone.
Il existe en effet de nombreuses situations dans lesquelles des firmes en concurrence ont un intérêt commun à coopérer dans un jeu gagnant-gagnant. C’est par exemple le cas quand des entreprises recherchent des complémentarités technologiques ou mutualisent certaines dépenses de développement. Un tel partage des coûts et des compétences est d’autant plus attractif dans un contexte où les entreprises sont confrontées à un raccourcissement du cycle de vie des produits et donc à l’exigence de rentabiliser plus vite les investissements tout en réduisant les risques. Enfin, une troisième incitation à la coopétition est à chercher du côté des stratégies de standardisation. En effet, la constitution d’alliances opportunistes entre des acteurs industriels influents, mais néanmoins concurrents, est un atout majeur dans la guerre pour imposer des standards à l’échelle mondiale. On peut ainsi citer l’exemple de la victoire du format Blu-Ray face au HD DVD. Une victoire permise par une large alliance de firmes parmi lesquelles figuraient notamment Sony, Pioneer, LG, Samsung et autres Panasonic…, autant d’opérateurs se livrant pourtant une concurrence acharnée sur le marché final des platines Blu-Ray.
La coopétition doit donc être perçue comme la convergence transitoire d’intérêts stratégiques. Transitoire, car la coopétition crée de facto des tensions entre le nécessaire partage des connaissances entre les entreprises, et leur toute aussi impérative protection. En un mot, un tel partenariat ne dure que tant que chaque partie y trouve son intérêt. Or, il n’est pas rare que, sous couvert de coopération, les coopétiteurs cherchent à tirer le meilleur avantage pour capturer plus de valeur que le partenaire. Il est vrai que les transferts de compétences et de ressources indispensables à la coopétition peuvent renforcer la compétitivité de long terme de la firme la moins-coopérative ! Que l’on songe à Nummi, joint-venture née de l’alliance de General Motors et de Toyota, pour s’en convaincre. Ce partenariat de circonstance masquait en fait un jeu de dupes où chacun des coopétiteurs cherchait à renforcer sa compétitivité vis-à-vis de l’autre : General Motors en voulant apprendre le fameux « Toyota Production System » pour mieux l’intégrer à ses propres chaînes de production, Toyota en profitant de cette alliance pour pénétrer rapidement le marché américain.
Le risque de pillage inhérent aux stratégies de coopétition exige en conséquence un management efficace et suspicieux. Tout d’abord, des précautions juridiques sont indispensables pour protéger la propriété intellectuelle de chaque partenaire, et prévoir le juste partage des fruits du co-développement, notamment en matière de brevets. Au plan managérial, l’expérience révèle deux grands types de dispositifs :
- le premier consiste à bien séparer spatialement la gestion des activités coopétitives et concurrentielles. Un choix qui implique de confier le pilotage de la joint-venture à un acteur tiers indépendant : cela peut être une filiale commune, un client, un syndicat professionnel, voire la puissance publique.
- Un second dispositif est envisageable ; c’est l’internalisation de la coopétition. Ici, point de séparation hermétique des activités. Il s’agit bien au contraire de former les équipes à savoir gérer les paradoxes de la coopétition, de les sensibiliser à l’intérêt d’échanger avec des concurrents, et de les éclairer explicitement quant aux avantages et limites du partenariat.
S’allier momentanément avec ses concurrents sur certains segments d’activités dans un jeu véritablement gagnant-gagnant exige donc un savoir-faire managérial sophistiqué. Une stratégie dans laquelle s’engage pourtant un nombre croissant de groupes multinationaux.
Les dernières vidéos
Stratégie




Les dernières vidéos
de Julien Pillot
-des-actifs-strategiques-les-4D--6832.jpg)


LES + RÉCENTES
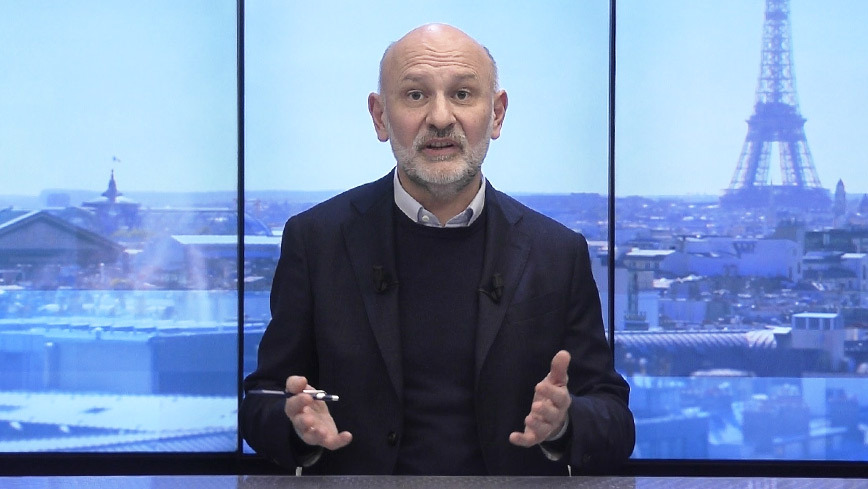


LES INCONTOURNABLES

-6494.jpg)