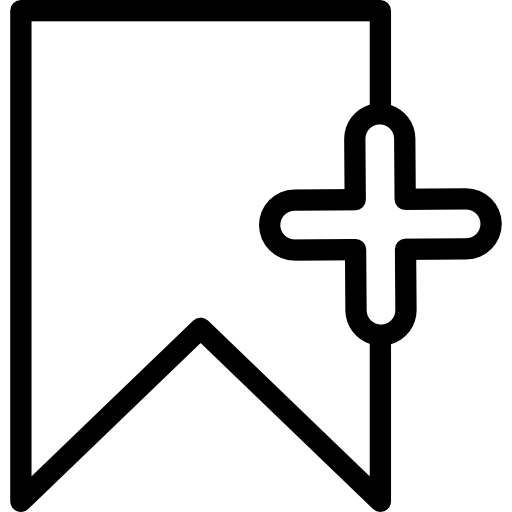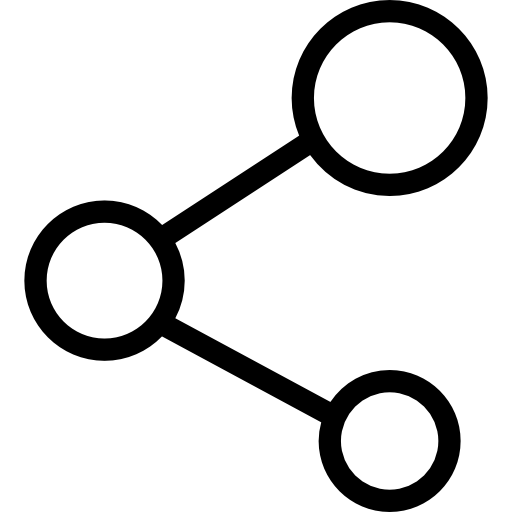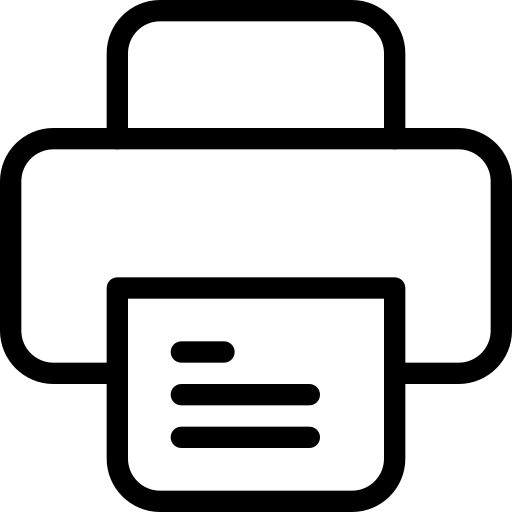On a souvent tendance à oublier que le sacrifice de ressources est la seule façon de mesurer ce à quoi nous tenons vraiment. Le terme de valeurs a été largement galvaudé par le capitalisme qui l’assimile trop souvent à une dégoulinade de bons sentiments. Mais montrer que l’on est attaché à une valeur – que ce soit la liberté, l’équité, la fraternité ou l’envie d’un monde plus juste- ne consiste pas à l’afficher sur un site ou une plaquette pour se donner bonne conscience. Défendre une valeur, c’est prendre conscience des efforts et des ressources que l’on est prêt à mobiliser pour faire vivre un principe de vie et d’action auquel on croit fermement. Défendre une valeur c’est donc renoncer à quelque chose. Telle est l’une des questions essentielles que pose l’idée même de sobriété qui, après avoir été largement moquée dans le débat public et politique, semble aujourd’hui s’imposer comme horizon ou du moins comme contrainte indépassable.
Mais pour que la sobriété soit le fondement d’un projet de société partagé, il faut d’’abord construire une utopie de la sobriété en l’associant à un imaginaire positif et désirable. Pour ce faire il importe de revoir notre vision souvent caricaturale de l’utopie pour envisager un véritable principe espérance dont parlait le philosophe Ernst Bloch. Mais pour nourrir cette espérance, il faut également sortir du paradigme de l’abondance illimitée, ce qui signifie qu’il va falloir accepter de changer radicalement nos modes de vie et arrêter de penser qu’une hypothétique parade technologique nous permettra un jour de sauvegarder une abondance perdue. Pour métamorphoser le système de production et de consommation, Il importe donc de partir des limites des ressources planétaires et non pas de notre niveau de confort. Il faut donc accepter d’opérer des renoncements qui seuls permettront de changer structurellement nos modes de vie. C’est en ce sens que « la sobriété est notre plus grande richesse » ; comme le résume justement le Bruno Villalba, professeur de science politique à AgroParisTech dans un ouvrage très stimulant, Politiques de sobriété. Arrêtons donc de penser la sobriété comme un impératif d’optimisation de la consommation d’énergie sans contrainte aucune pour le secteur marchand. Regardons lucidement les énergies « vertes », le recyclage, et même le nucléaire comme des « logiques d’innovation et d’efficacité » qui servent essentiellement à justifier et à nourrir un discours performatif destiné à «maintenir vivace la promesse de l’abondance ».
Certes la perspective du renoncement n’est guère plaisante. Mais pour autant, il est possible d’envisager la sobriété comme un idéal positif permettant de repenser notre liberté. Celle-ci ne signifierait plus une absence de contraintes, mais plutôt une adhésion collective à une règle dans laquelle seraient prises en compte les conséquences de chaque chose sur l’ensemble des vivants. A ce titre, le renoncement serait un apprentissage de la réalité et permettrait de nous faire grandir, alors que le capitalisme ne cesse de nous infantiliser. Davantage qu’un étalon ou un élément coercitif, la sobriété peut donc être un outil permettant de comprendre ce que l’on est prêt à perdre et pourquoi il est utile de le perdre. Cette rationalisation de la sobriété est donc aux antipodes d’un discours politique et culturel la ravalant au seul registre des émotions dulcifiées pour mieux rendre invisibles ses effets dérangeants.
Publié le jeudi 15 février 2024 . 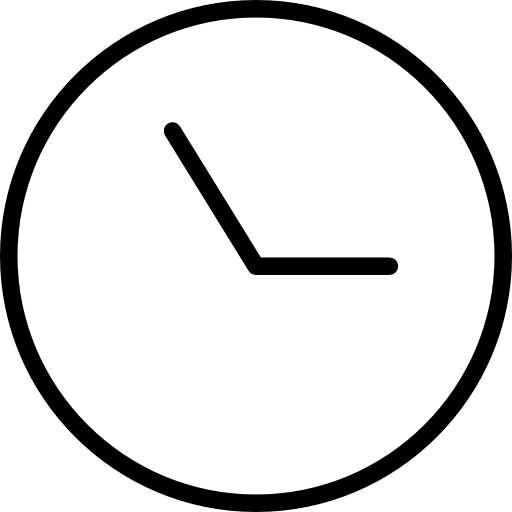 4 min. 04
4 min. 04
Les dernières vidéos
Energie, Environnement




Les dernières vidéos
de Benoît Heilbrunn




LES + RÉCENTES
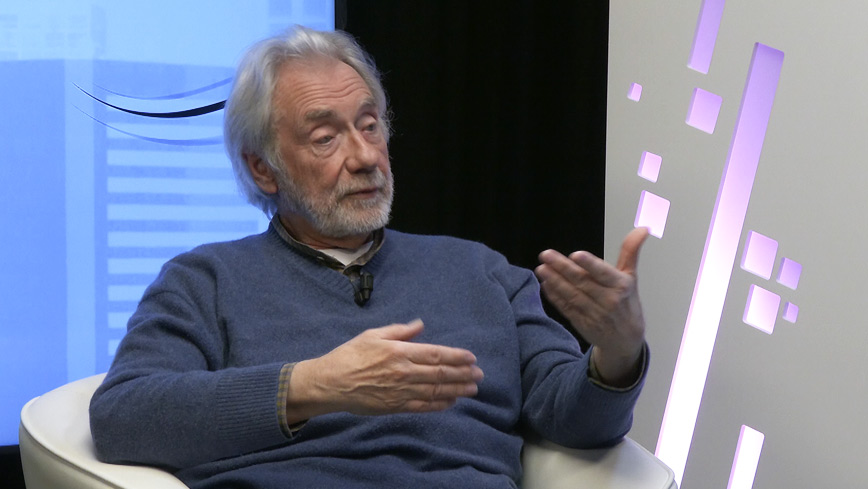
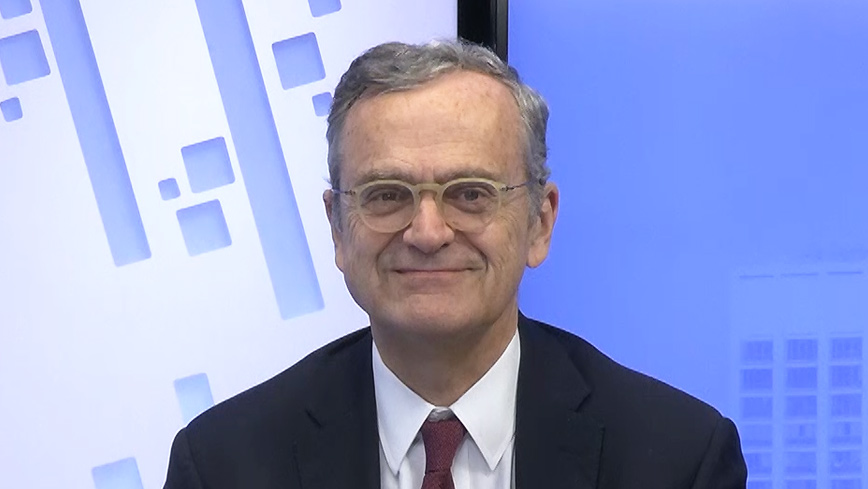


LES INCONTOURNABLES