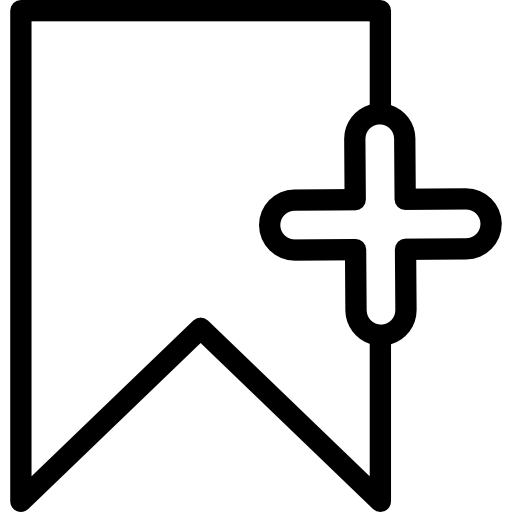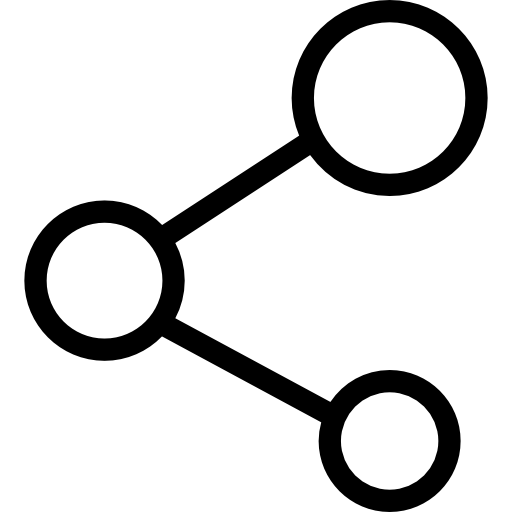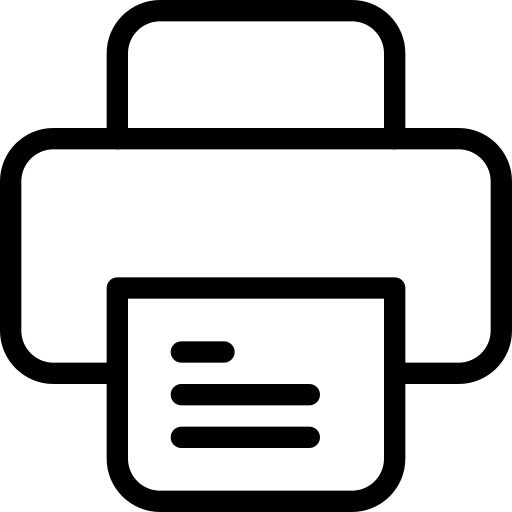La sphère financière peut-elle craquer avec la crise du Coronavirus ? Ou plutôt, comment pourrait-elle ne pas craquer emportant avec elle dans un désastre systémique toute l’économie réelle. Cette peur d’un effondrement fatal est intimement liée à cette conscience que nous avons tous aujourd’hui du talon d’Achille financier. Comment la sphère du pari sur la rentabilité des investissements, sur la capacité à rembourser des agents privés, sur les promesses des nouveaux modèles d’affaires pourrait-elle survivre à la mise à l’arrêt imprévisible et stupéfiante de plus d’un tiers de l’économie marchande sur plusieurs semaines ou mois, qui ruine les promesses de retour sur investissement à travers toute la planète. Imaginer le contraire pourrait même être perçu comme un déni caractérisé.
Alors certes cette crise n’est pas celle de 2008 et encore moins celle de 29. Non sa racine n’est pas financière. Le point de départ de l’histoire n’est pas celle d’une euphorie aveugle des investisseurs financiers qui vire en ruine des épargnants. Sa racine est réelle. Et paradoxalement, nous sommes à front renversé par rapport à 2008. Les banques sont devenues la planche de salut de l’économie réelle. Ce sont elles qui permettent de faire la jonction entre le moment où l’économie s’est arrêtée et le moment où les affaires reprendront, sans casse des capacités et de l’emploi. 1/ Parce que les banques et les fonds de gestion, drainent l’épargne forcée du confinement vers les titres publics ou prêtent aux États, pour que ces derniers prennent le relai des entreprises à l’arrêt dans le versement de salaires. 2/ Parce qu’elles fournissent aussi la liquidité aux entreprises à court de trésorerie, pour éviter des défauts en chaine qui transformerait la contagion du COVID 19 en contagion de faillites. De ce point de vue, cette crise est presque expiatoire pour la finance. Alors que son sauvetage et que la réparation ses dégâts collatéraux sur l’économie réelle ont coûté plusieurs dizaines de point de PIB de dette, reportant sur les agents privés et les budgets sociaux la charge du remboursement, elle est l’occasion pour la finance de racheter sa faute. Mais a-t-elle l’échine assez forte pour encaisser le choc. La question est là.
La réponse est oui, mais jusqu’à un certain point. Oui d’abord parce que les banques centrales veillent au grain. La BCE, a montré dans la soirée du 18 mars, qu’elle était prête techniquement et quantitativement à mettre en œuvre tous les outils qui diffèrent une crise de liquidité : TLTRO + rachat d’actifs, c’est la bithérapie, testée en grandeur réelle avec succès en 2008, que la banque centrale relance et dimensionne à la hauteur du choc. Nul ne doute qu’elle amplifiera encore son action si nécessaire. A cela il faut ajouter l’allègement des exigences de fonds propres et des contraintes opérationnelles des banques. Bref, la BCE est mobilisée pour que les banques continuent à remplir leur rôle de financement de l’économie réelle. Et c’est bien cela qui nous permet encore de garder l’espoir d’un choc circonscrit, où les agents privés se retrouveraient dans quelques semaines avec des revenus presque intacts, et des capacités préservés, pour redémarrer vite et rattraper une partie du terrain perdu.
Ce faisant, les banques se retrouvent avec un surcroît de volume d’activité en direction des entreprises qui compense pour partie le reflux des opérations destinées aux ménages ou à l’investissement. Mais adossé à des crédits très vulnérables. Qui demain peut charger leurs bilans en créances douteuses irrécouvrables et se transformer en perte. Sauf que là encore, les États ont pris les devants en garantissant 90% des avances de trésorerie. Les banques sont choyées car sans elles rien n’est possible. Et derrière l’engagement de la finance, il y a un trompe-l’œil total. Nul héroïsme sacrificiel. Ce sont les contribuables qui portent le risque à travers les garanties de l’État, à travers le financement des pertes de la banque centrale si les choses tournent mal. Et tout ce qui est avancé, reste dû, différant le coût, sans l’annuler. Résultat, le plus gros risque pour les banques, c’est l’après. Une crise qui n’en finit pas au plan macro, et laminerait leurs sources de revenu dans la durée, avec une pente des taux écrasés pour des années encore. Le sauvetage réussi à court terme, de l’économie réelle par la finance, peut se transformer et poison lent.
Et puis, il y a les retombées de l’effondrement des prix d’actifs. Les bourses ont déjà dévissé de 35% entre leurs sommets de février et leurs points bas du 23 mars. Ce n’est sans doute pas fini et ce n’est pas tout. L’effondrement des prix de l’énergie met par exemple à mal tout un secteur sur lequel les banques américaines sont fortement engagées etc. Alors certes, les intermédiaires financiers portent très peu le risque action en compte propre. Les banques et les fonds de gestion qu’elles contrôlent les gèrent pour le compte de leurs clients et se rémunèrent par commission, perte ou pas perte. C’est d’ailleurs ce qui sauve le chiffre d’affaires bancaire depuis des années. Sauf, que cet effondrement, met en panne les banques d’investissement, fait plonger le capital investissement, ralentit l’activité des fonds de gestion d’actifs, met sous pression leurs commissions etc. Les banques vont donc bien vivre un choc de revenu et de rentabilité à court terme.
In fine, sous surprotection des états et des banques centrales, on peut avoir le sentiment que ça passe pour la finance. Mais à plus long terme, et surtout si l’horizon de sortie est reporté sine die ça peut casser.
Publié le mardi 31 mars 2020 . 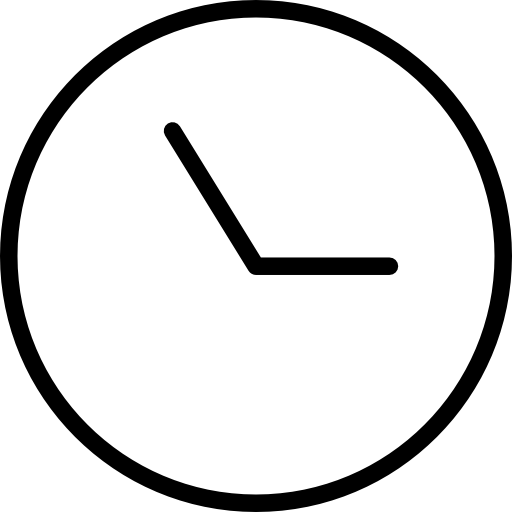 6 min. 27
6 min. 27
Les dernières vidéos
Économie mondiale




Les dernières vidéos
d'Olivier Passet

LES + RÉCENTES
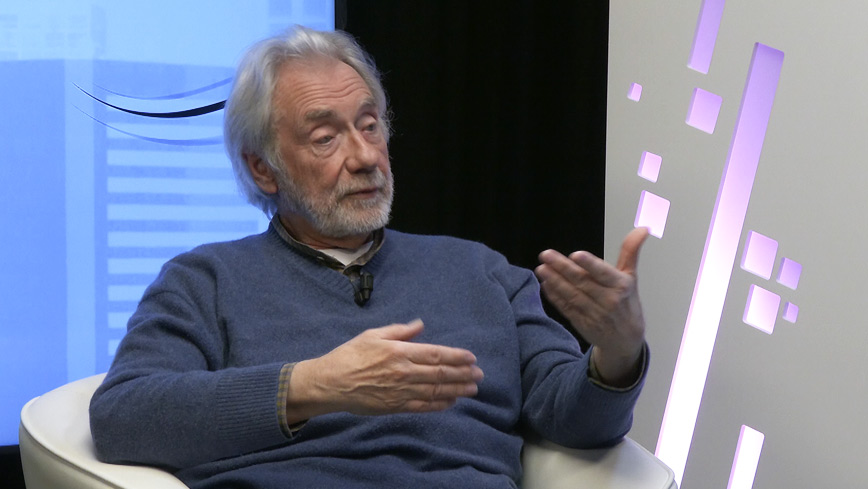



LES INCONTOURNABLES