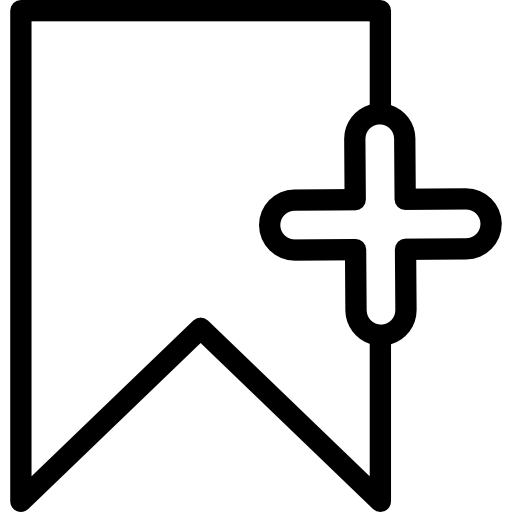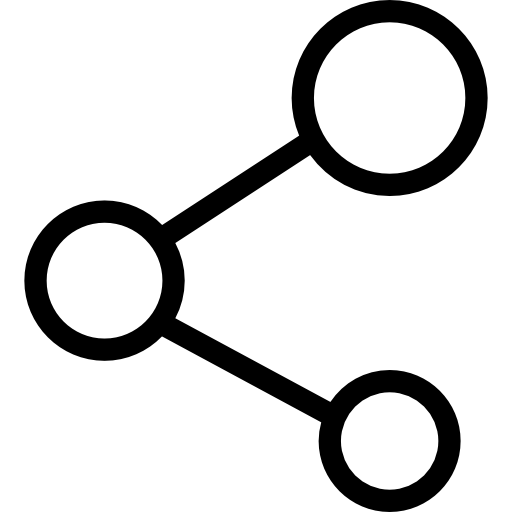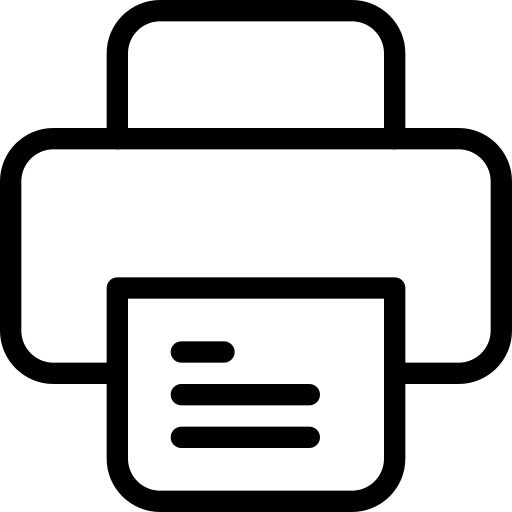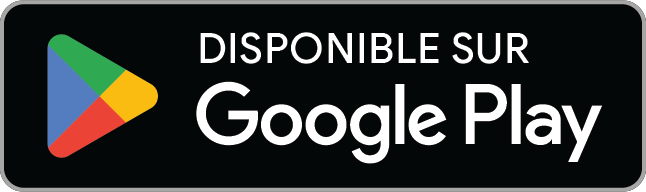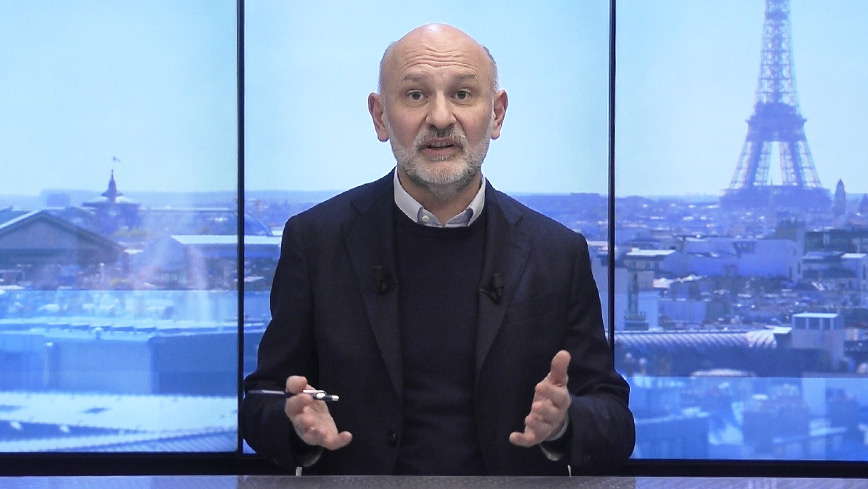Mon billet libéral du jour porte sur la meilleure manière de réussir la transition écologique. Pas sur les mesures à prendre. Pas sur le mix énergétique idéal. Pas sur le calendrier le plus adéquat. Ni encore sur l’urgence de décarboner notre économie.
Non, sur une question plus fondamentale ; elle se joue aujourd’hui en coulisse : qui du marché ou de l’Etat est le plus à même de mener cette révolution ?
Résumons trois actes, comme dans tout bon drame...
Acte 1: à l'origine, la transition écologique devait reposer sur le marché. Un consensus s’établissait : les choix technologiques, les nouveaux modes de vie devaient être du ressort des agents privés. Avec l’Etat, bien sûr. Mais l’Etat devait se contenter de fixer un cadre. Et d’abord de fixer un prix à la pollution via la taxe carbone.
Je parle à l’imparfait parce que, acte 2, la crise des Gilets jaunes est venue bousculer ce scénario. En France, la hausse de la fiscalité carbone est suspendue depuis 2018.
Explication de cet échec :
L’acceptation sociale d’un coût toujours plus élevé de l’énergie fossile a été sur-estimée. Erreur fatale, le gouvernement n’a pas redistribué aux ménages l’intégralité des recettes des nouvelles taxes. Soit sous forme de chèque pour compenser la perte de pouvoir d’achat. Soit sous forme de subventions à la décarbonation.
Acte 3: Le front s’installe. D’un côté, les économistes comme Jean Pisani-Ferry. Le chercheur à l’Institut Bruegel prend acte de la mort de la taxe carbone et réclame une transition par la norme, par la planification : l’Etat redevient chef d’orchestre. Il change par la loi les règles du jeu. Il planifie.
D’un autre côté, les économistes libéraux, comme Christian Gollier. Le directeur général de la Toulouse School of economics est remonté contre un enterrement trop précoce de cette taxe. Une incitation très efficace ; elle aligne tout le monde sur l’intérêt général…
C’est en quelque sorte le Plan contre la taxe.
Autant dire que les premiers ont pris le dessus. Au Parlement européen, les eurodéputés vont voter la taxe carbone aux frontières, applicable dès 2026. Mais elle ne se justifie que pour compenser le prix des émissions de CO2 supporté par les entreprises, les ménages n’étant pas taxés…
C’est une triple erreur, nous dit Christian Gollier.
Un : on cache à la population le vrai coût de la transition écologique. La taxe carbone est une façon d’expliciter ces sacrifices. Oui, elle sera douloureuse… C’est la vérité par le prix. A l’inverse, l’accroissement des normes, sur l’isolation thermique des maisons par exemple, a un coût caché…
Deux : les alternatives à la taxe, subventions et bonus-malus, sont opaques. Pire, elles sont autant, si ce n’est plus inégalitaires qu’une taxe. Les subventions versées dans les années 2010 pour l'installation de panneaux solaires ont été financées par une taxe sur l’électricité payée par tous, y compris les plus modestes.
Trois : Il faut des normes bien sûr. Mais elles doivent être calibrées en tenant compte du rapport sacrifices financiers/bénéfices écologiques. L'avantage de la taxe carbone universelle et sans exception, nous dit Christian Gollier, c’est d’avoir une jauge commune visant à donner une valeur à ce qui nous est cher: notre environnement.
Publié le jeudi 7 juillet 2022 . 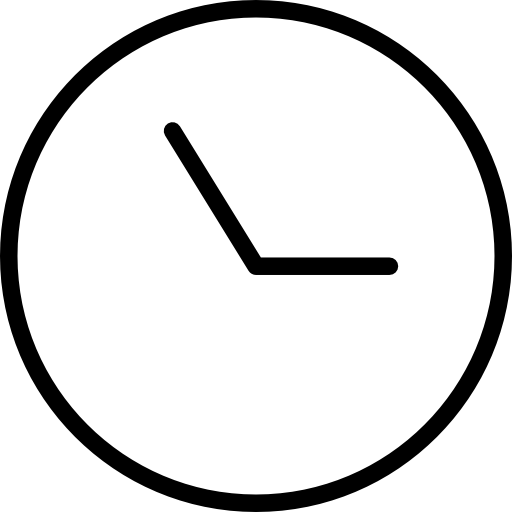 4 min. 02
4 min. 02
Les dernières vidéos
Politique économique


Les dernières vidéos
de Rémi Godeau


LES + RÉCENTES
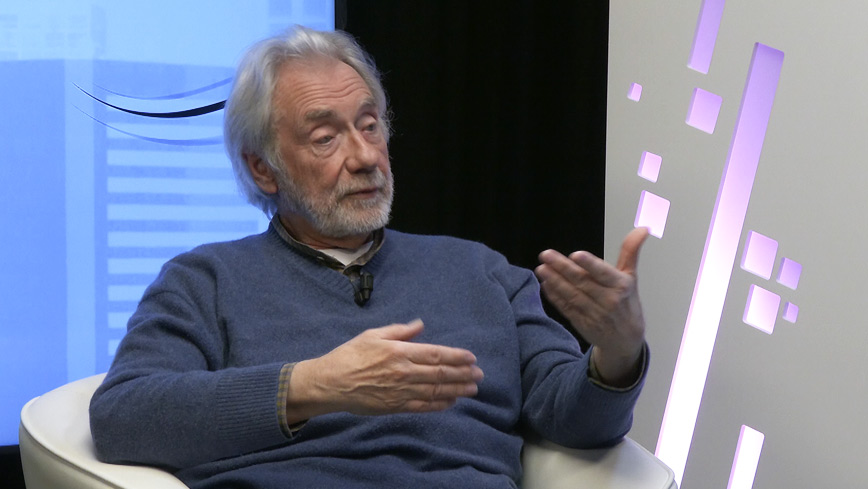
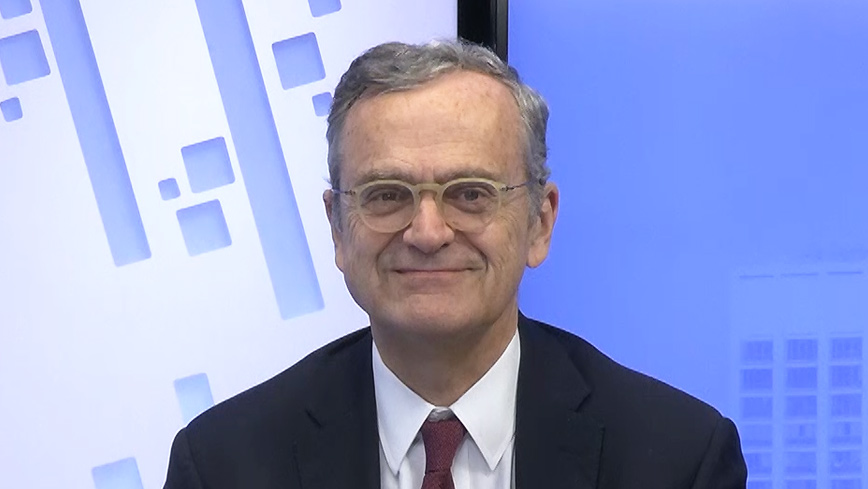


LES INCONTOURNABLES