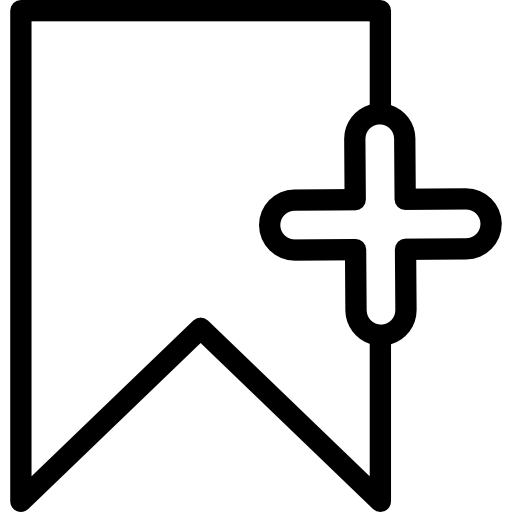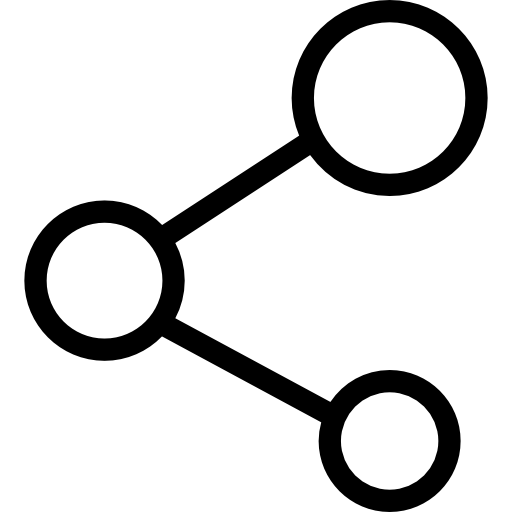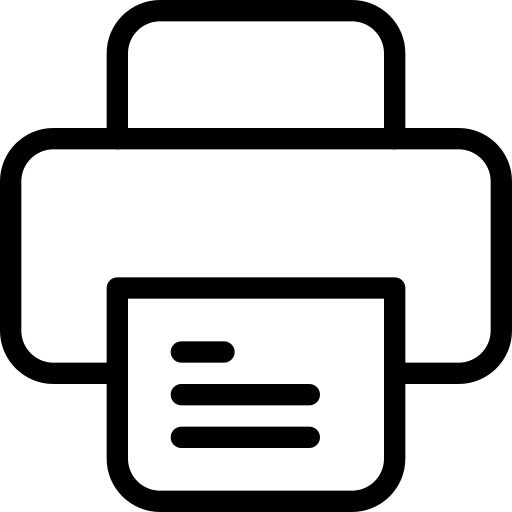C’est un constat. L’emploi résiste étonnamment bien aux tempêtes de l’économie depuis 15 ans. Et encore aujourd’hui, après le Covid, la guerre en Ukraine, la fièvre inflationniste, il continue à croitre ou à résister, déjouant tous les pronostics. Or, les économistes demeurent généralement silencieux sur ce changement de régime.
Le rôle de la politique monétaire
Partons des faits d’abord, en dépassant la conjoncture des derniers trimestres. Sur moyenne période, car l’anomalie n’est pas récente, le taux d’emploi a cru en dépit de la succession des crises depuis le choc des subprimes. Comparé aux pics de 2007-2008, le taux d’emploi des pays de l’OCDE est aujourd’hui au plus haut, avec un distinguo entre la zone euro où il surplombe de près de 4 points ses pics de 2007-2008, et les US où le taux d’emploi a juste recollé à ses pics précédents. Certes, la croissance de la population en âge de travailler décélère. La hausse des taux d’emplois tient aussi en partie à l’attrition du dénominateur.
Mais prenons les choses autrement. Comparons la croissance des 15 dernières années (2007-2022) à celle des 15 précédentes (1992-2007). La cassure est nette. En zone euro, elle décroche de 2,1 à 0,8% en rythme annuel. Idem pour la France. En Allemagne, elle passe de 1,5 à 1,0% et aux États-Unis de 3,2 à 1,7%. Estimons maintenant ce qu’aurait été la croissance de l’emploi si le contenu en emploi de la croissance entre 2007-2022 avait été le même que celui de la période précédente. Partout, nous aurions dû observer une destruction d’emplois comprise entre -0,1 et -0,4% par an. Or, que voyons-nous ? Tout le contraire. Les rythmes de croissance de l’emploi s’étagent entre +0,5 et +0,8% :
La première raison évidente tient à l’orientation ultra-expansive des politiques monétaires depuis 2008. La décrue des taux d’intérêt a tout à la fois facilité le financement externe des entreprises et réduit très nettement les poids des charges nettes d’intérêt des sociétés non financières, aux États-Unis comme en Europe. Ce contexte a fortement allégé le stress sur les marges des entreprises et in fine sur l’emploi. À quoi l’on pourrait ajouter en arrière-plan la tendance à une décrue tendancielle du prix des matières premières, jusqu’en 2020.
Des profils d’emplois non indexés sur le cycle
La seconde raison tient à la modification de la structure des emplois des pays avancés, avec une part de plus en plus faible d’emplois de première ligne directement dédiés à la fabrication et indexés sur la production. Or, ces emplois sont devenus très minoritaires. Les emplois qui s’ajustent le plus fortement en période de crise sont les emplois ouvriers de l’industrie, ceux de la construction ou de l’intérim (très fortement volatils et précarisés). Quant aux petits emplois de services, pour partie ubérisés, c’est par les heures de travail qu’ils s’ajustent de plus en plus au cycle.
Nos emplois sont d’abord des emplois dédiés à la maintenance de l’existant. Ils n’ont pas vocation à propulser la croissance mais à maintenir le système l’état, le reproduire. À force de nous focaliser sur les flux, nous oublions les moyens croissants que doivent déployer nos économies pour simplement conserver en l’état leur capital matériel et immatériel pléthorique. Ces emplois de maintenance sont de tout ordre, qualifiés ou non qualifiés, mais n’ont aucune raison à être indexés sur le cycle : de la santé à l’éducation, la dépendance (pour conserver notre capital humain), en passant par le gardiennage, la sécurité, l’entretien-nettoyage-réparation, la rénovation, le contrôle technique, la maintenance des équipements (notamment informatiques), la conservation d’art, etc., concernant le capital physique. Et le moindre relâchement en la matière revient en boomerang, menaçant de déstabiliser le socle même de notre croissance, à l’instar du psychodrame que vit la France concernant son secteur de la santé ou du très lourd prix à payer de nos relâchements en matière d’entretien de nos infrastructures, comme le rappelle la mise à l’arrêt de plus d’une trentaine de réacteurs nucléaires en 2022.
Ce sont ensuite des emplois de gestion de la complexité : de supervision, d’ingénierie, de R&D, de conseil, de conception, de communication. Bref, ces emplois de cadre et ces professions intellectuelles qui alimentent « les bataillons de la bureaucratie d’entreprise » pour reprendre le terme de David Graeber. Leur part n’a cessé d’augmenter. Ils sont le noyau parfois évanescent (voir contesté lorsque l’on évoque les bullshit jobs) de nos économies de la connaissance, considérés comme le capital immatériel des entreprises, et à ce titre, étanches aux aléas d’activité.
Le digital ajoute de la complexité
Troisième argument enfin, que j’ai maintes fois évoqué lors de précédentes vidéos. Le digital n’est pas, contrairement à ce jour, une automatisation des tâches intellectuelles qui phagocyterait l’emploi. Il ajoute au contraire une couche de complexité supplémentaire à nos process, augmentant les tâches et les cahiers de charge plus que la production.
Bref, nos économies avancées prises dans leur globalité se rapprochent de plus en plus de systèmes de production à coûts fixes, dédiant des moyens croissants à leur propre conservation et à la gestion de leur complexité, et externalisant la fabrication des choses. Ces emplois ont leur loi de croissance propre. Et avec ou sans activité, ils résistent de mieux en mieux, surtout si les banques centrales, par leur acharnement thérapeutique, garantissent la solvabilité du système.
Publié le lundi 13 février 2023 . 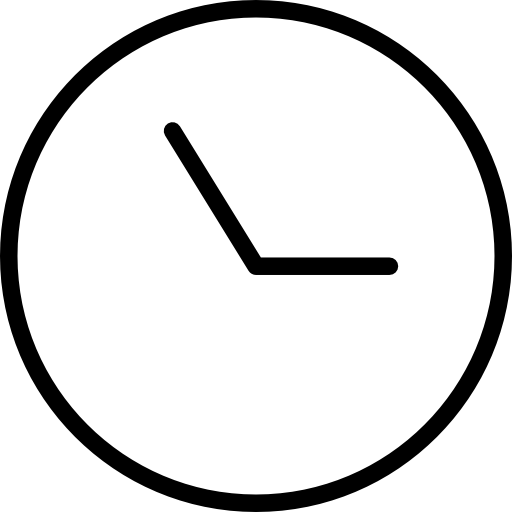 6 min. 09
6 min. 09
Les dernières vidéos
Emplois, travail, salaires
? Gilles Rotillon 31/05/2024

Les dernières vidéos
d'Olivier Passet

LES + RÉCENTES
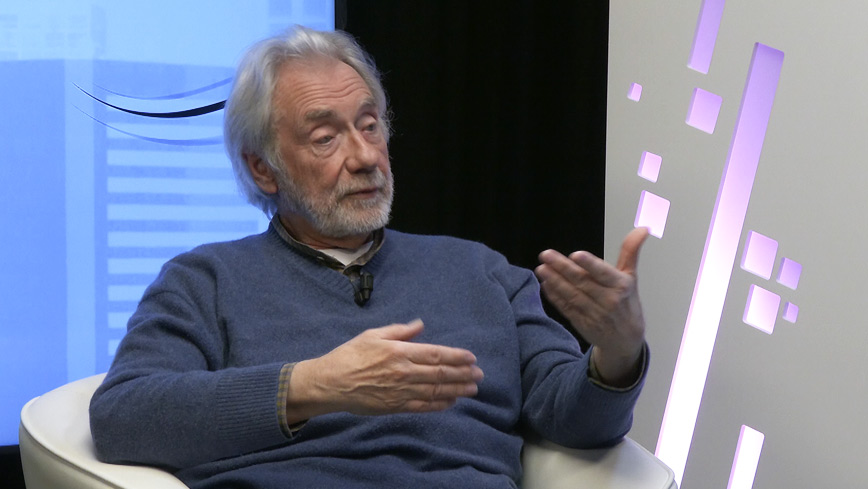



LES INCONTOURNABLES