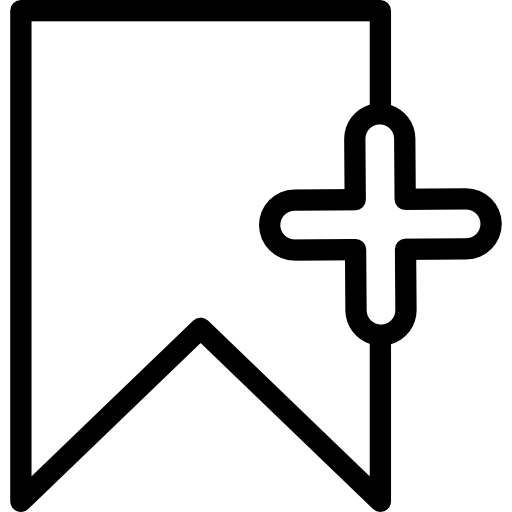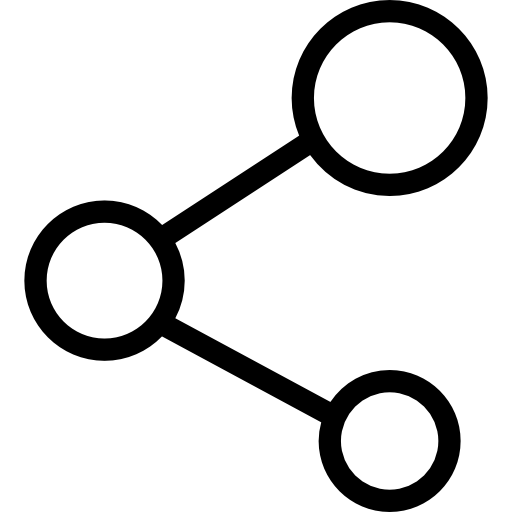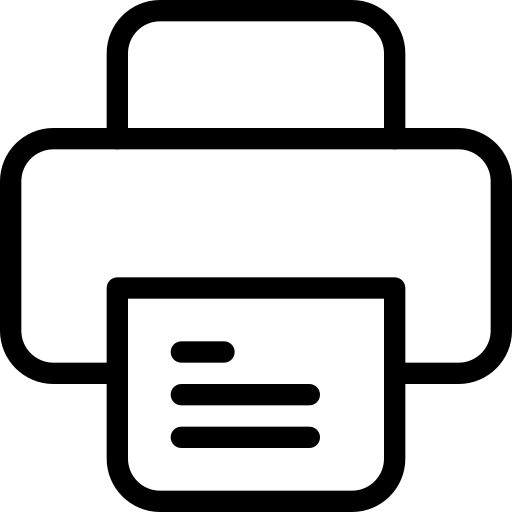Les barrières à l’entrée, c’est ce qui limite l’accès d’une entreprise à une industrie. Et ce concept est central dans les théories de la concurrence et en stratégie d'entreprise. Il a fait l'objet de nombreux travaux en économie industrielle, allant de Joe Bain dans les années 1950 à Mickael Porter dans les années 1980. La définition précise d’une barrière à l’entrée varie d'une discipline à une autre, mais reprend le plus souvent l'idée centrale d'importance des obstacles pour qu’un nouvel entrant parvienne à pénétrer un marché. Les financiers parlent, eux, de « ticket d’entrée élevé ».
Rappelons tout d'abord que les barrières à l'entrée peuvent être plutôt structurelles, résultant d'une configuration de marché donnée, ou au contraire plutôt stratégiques, c'est-à-dire construites à dessein par les opérateurs en place. Mais la frontière entre ces deux catégories n'est pas toujours évidente. Je vous propose de nous concentrer ici sur les barrières structurelles les plus importantes. Les barrières stratégiques, elles, sont analysées dans une autre émission.
Tout d’abord, la législation reste aujourd'hui une barrière à l'entrée majeure sur un grand nombre de marchés. Citons par exemple les tarifs douaniers, les normes spécifiques à un pays, les monopoles publics, les restrictions à l'investissement étranger, les quotas ou encore les autorisations administratives. La capacité d'une entreprise à pouvoir contourner ces obstacles dépend largement de l'influence qu'elle peut exercer sur le régulateur.
Mentionnons également les barrières juridiques liées à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle. C’est par exemple le cas des brevets qui constituent une barrière à l'entrée majeure sur de nombreux marchés. Ces mécanismes de protection de la propriété intellectuelle sont un enjeu déterminant pour favoriser les opérateurs en place. Ainsi, les majors de l'industrie pharmaceutique ou du divertissement par exemple déploient des moyens de lobbying considérables pour s'assurer que leurs brevets et licences soient protégés aussi longtemps que possible.
Il faut par ailleurs attirer l’attention sur les effets d’expérience. La courbe d'expérience veut que le coût unitaire décline avec la production accumulée au fil du temps par l'entreprise. Autrement dit, à production momentanée égale, les coûts du nouvel entrant seront plus élevés à court terme. Cette courbe d'expérience repose sur les économies d'échelles et les effets d’apprentissage. Cette barrière à l’entrée encourage les nouveaux entrants à innover et à déplacer la concurrence vers des offres radicalement différenciées, générant ainsi une nouvelle courbe d’expérience.
Certains types de dépenses, comme la R&D ou le marketing, sont également inhérent à certains marchés. Reprenons l’exemple de l'industrie pharmaceutique. Ces barrières élevées ont conduit certains opérateurs à se focaliser exclusivement sur les médicaments génériques, aux marges unitaires moins élevées, mais dont les brevets sont passés dans le domaine public. D'autres opérateurs tentent de contourner ces barrières en mutualisant leur R&D avec d'autres concurrents et organismes publics ou privés, acceptant toutefois de partager les bénéfices éventuels sur la future molécule brevetée.
Les sunk costs, que l'on peut traduire par "coûts irrécupérables", peuvent également être très dissuasifs. Ils désignent les dépenses engagées par l'entreprise dans le déploiement de son activité et qui ne peuvent être recouvrés en aucune manière en cas d’échec. Cela constitue un frein important à la pénétration d’un marché. Pour atténuer l'impact de ces sunk costs, il existe néanmoins de nombreuses solutions permettant d'abaisser le seuil d'investissement minimum : pensez, dans le monde du logiciel, à toutes les solutions hébergées dans le cloud et disponibles sur des modèles d'abonnement ou de tarification à l'usage.
Terminons avec les effets de réseau qui sont des barrières majeures dans la sphère digitale. On parle d’effets de réseau quand la valeur ou l’utilité d’un bien ou d’un service pour un utilisateur dépend du nombre des autres utilisateurs. Par exemple : plus il y a d’utilisateurs d’un réseau social, plus la valeur de ce réseau augmente. Les offres concurrentes partent donc avec un réel handicap si ces effets de réseau sont puissants. Elles peuvent toutefois essayer d'être aussi compatible que possible avec le standard existant, essayer de favoriser la migration vers un nouveau service, voire essayer de créer un nouvel espace stratégique où ces effets de réseau ne seront plus une contrainte.
Pour autant, aucune barrière à l'entrée, même structurelle, n’est infranchissable. Il suffit de regarder l’évolution du classement des 200 premières firmes mondiales au cours des 30 dernières années : certaines ont disparu, d’autres sont devenues des géants et d’autres encore se sont créées ex nihilo comme les GAFA, les groupes du numérique. Cela révèle combien les règles du jeu concurrentiel évoluent au fil du temps et combien les barrières à l’entrée, qu’elles soient structurelles ou stratégiques, sont souvent surmontées, y compris sur des marchés qui semblaient protégés.
Publié le mardi 21 novembre 2017 . 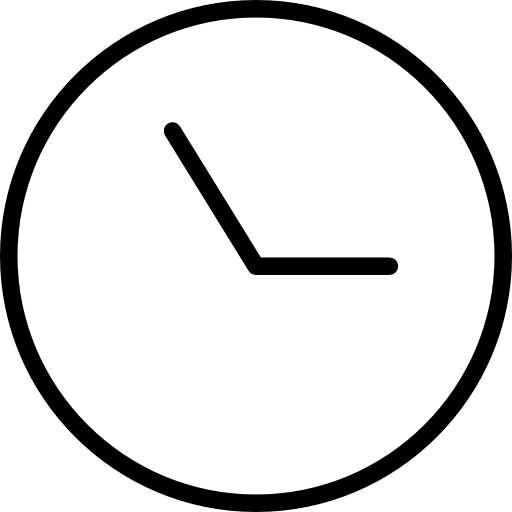 5 min. 06
5 min. 06
Les dernières vidéos
Comprendre



Les dernières vidéos
de Philippe Gattet



LES + RÉCENTES
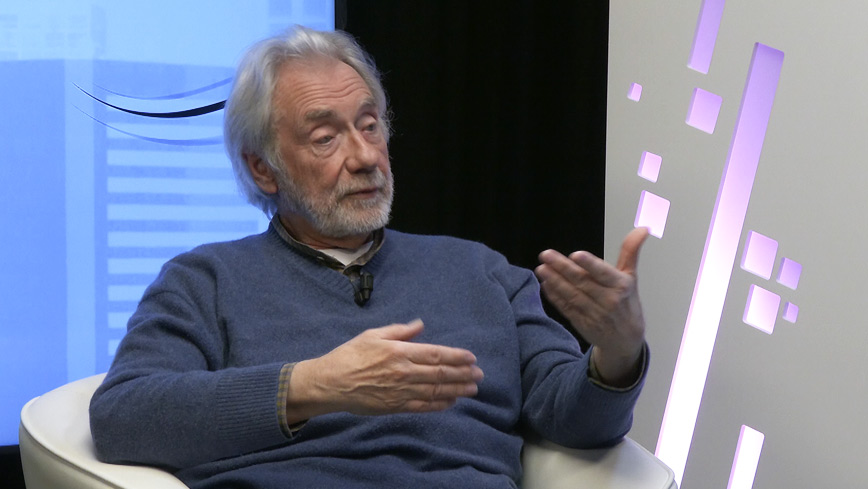
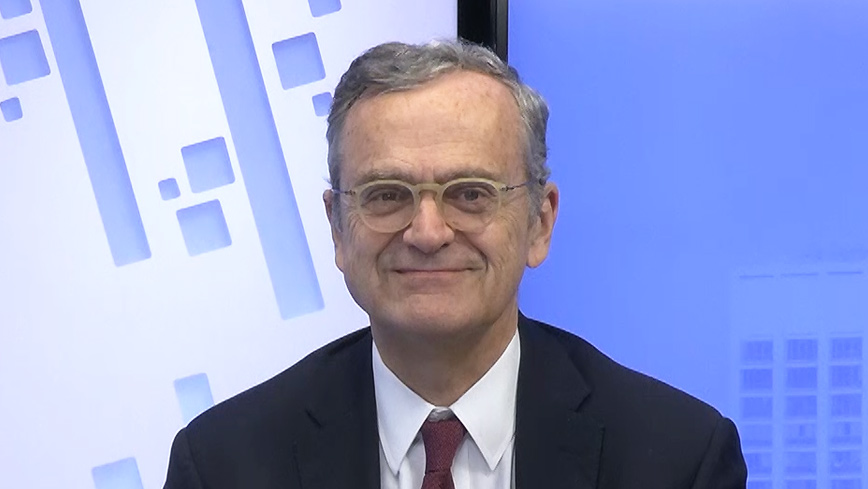


LES INCONTOURNABLES